le petit karouge illustré
les babillages de Chinette, les coloriages de Chinou
Être poète, c’est avoir un petit vélo dans la tête.

Je ne parlerai pas ici de la poésie astro-physicienne des trous noirs et des fontaines blanches, ni de la beauté d’une équation mathématique, quand celle-ci, en son résumé d’écriture, génère tant de possibilités magnifiques pour l’avenir des hommes. Et ce pour diverses raisons aussi variées que véritables. Tout d’abord, je ne sais ni lire une équation ni voir avec des jumelles la profondeur éblouissante du ciel et de ses composantes illuminantes. Ensuite parce que mon patron, qui lui me surveille avec ses jumelles et lit dans mes pensées (sauf en dehors des heures de travail) m’inviterait à ne plus écouter France Culture quand je me déplace d’un lieu à un autre, sous prétexte que je course une météorite quand je suis censé trouver des diamants dans les perles de rosée. Bref, je ne parlerai que de la poésie qui colle à la peau de ceux qui la ressentent, c’est-à-dire celle de monsieur Toutlemonde et de madame Vouzémoi.
La poésie est à la fois une passion et un combat. Inutile de la chercher ailleurs qu’en soi, vous la trouveriez chez un autre, plus lyrique et sensuelle que vous ne pensiez la ressentir en vous. C’est une catharsis. Chez les curés une épectase (je dis cela pour vous apprendre des mots nouveaux, avec lesquels on peut faire des rimes). Bien entendu, les lecteurs de ce site manient mieux la langue des chiffres que celle des chats. Donc, je vais parler d’autre chose, ce qui n’est pas coutume, mais pour cela je me dois d’aller m’habiller en coureur cycliste, pour être plus crédible, pour mettre à mon propos un peu plus de muscles, de tripes, de boyaux et de souffle, bref coller à la roue de mon discours tout en évitant de tourner en rond, sauf les jambes (sinon on n’avance pas).
Ainsi, comme tous les ignares, je trouvais plus de poésie, d’élégance et de distinction à la bicyclette comparé au vélo, plus âpre, plus masculin, un brin machiste. Le samedi, quand j’ai deux ronds, je file chez le libraire. C’est un peu comme chez Emmaüs, on trouve tout, sauf que c’est neuf et toujours sous la forme de bouquins. Vous cherchez un oiseau exotique, une encyclopédie sur les poissons rouges, les ïles de Jean Grenier ; vous croisez au détour d’un rayonnage l’Enterrement à Sabres (Bernard Manciet, édition bilingue), le truand don Pablo de Ségovie faisant la vie ((Francisco de Quevedo), des poésies de Jules Supervielle, de Jean Genêt, et des libraires érudits qui sourient mieux que le chat du Cheshire de Lewis Carroll (à ne pas confondre avec scarole, qui est une salade). Et vous tombez sur un petit bouquin, qui manque l’échappée belle (c’est le dernier exemplaire du libraire), je me souviens du Tour de France dans les Pyrénées (*), un ouvrage collectif rassemblant divers témoignages de champions cyclistes locaux et nationaux, de passionnés du vélo dont le souvenir s’efface peu à peu, au rythme des couches de macadam dont on tapisse l’Aubisque et le Tourmalet, l’Aspin, régulièrement.
Alors, me direz-vous, quel rapport avec la poésie ?
Tout d’abord, le lieu, les lieux, la montagne, les cols, les routes qui ne sont que des chemins carrossables. Le temps, magnifique, caniculaire, orageux, diluvien. La distance (Bayonne-Luchon 326 km), le matériel rudimentaire (pas de dérailleur, interdiction de changer de vélo de même marque, nécessité de réparer soi-même son matériel…), pas d’assistance. Les hommes enfin, magnifiques, magnanimes, héroïque (Victor Fontan se bricolant -il avait cassé sa fourche- chez le forgeron du village un vélo avec celui du facteur, qui n’avait rien d’un engin de course, en y recasant ses roues, son guidon et sa selle). La force, la ténacité, le respect total de l’adversaire, et le fair play (que je n’ai revu qu’exceptionnellement dans d’autres sports, de nos jours), la dignité et le courage, tous ces ingrédients qui font que ces hommes créaient une liesse populaire à leur passage (sans parler d’Yvette Horner dans sa deux-chevaux, jouant de l’accordéon) et entraient pour certains dans la légende de la Grande Boucle. C’est en et par cela que la poésie est à la fois une passion et un combat : elle est capable de se répandre par sa volonté propre, d’inonder l’espace qu’elle franchit d’une autre vision des choses, de croire en l’homme qui réalise l’exploit autant qu’en celui qui le regarde. Elle est personne et tout le monde.
Et je rejoins le point de départ : je ne parlerai pas ici de la poésie astro-physicienne des trous noirs et des fontaines blanches, ni de la beauté d’une équation mathématique quand celle-ci, en son résumé d’écriture, génére tant de possibilités magnifiques pour l’avenir des hommes.
Autant Stéphane Hessel s’exclam(ait) « indignez-vous ! », autant faudrait-il dire aussi : « tenez bon le guidon, soyez des hommes, ne lâchez rien de vos convictions ! », et à Sally Mara (de Queneau) : « tiens bon la rampe ! », afin que chacun et chacune y trouve son plaisir, sa force et sa raison de vivre.
10 01 2011
AK
(*) édité par Association Mémoire Collective en Béarn bulletin n°21, avec plein d’anecdotes et d’illustrations d’époque (pour info)
(mon texte a été trouvé par hasard, coincé entre deux magazines, sans doute depuis pas mal d’années !)
(en 2011, je collaborais dans un blog palois assez lu, disparu depuis, en écrivant un texte chaque samedi… )
J’ai honte : je n’ai pas pris le temps !

Demain un nouveau dictateur va être honoré aux zamériques. Je voudrais bien m’installer dans les pages d’une bande dessinée mais n’ayant aucun album d’icelui (tournure très joulie), aucune ancre où plonger quelque chose d’amusant, de ludique, (« on ne peut pas tuer par la colère, mais on peut tuer par le rire », Nietzche cité par Lucchini ce dimanche soir sur France Inter). Bon, pour assumer ma honte j’avoue avoir pioché tout cet article dans wikipedia. Cependant, quand le temps sera venu, je voterai pour Razibus Zouzou et Bibi pourra fricoter avec qui bon lui semble, mais en totale démocratie planétaire.
Historique d’un monde pré-histérique :
Louis Forton, le créateur de la bande dessinée des Pieds Nickelés (créée 16 ans plus tôt) imagine et lance le personnage de Bibi Fricotin. Initialement destiné à exercer la fonction de lad dans une écurie, métier exercé par Forton dans sa jeunesse, le jeune homme apparaît pour la première fois le 5 octobre 1924 dans Le Petit Illustré no 1043.
Lorsque Louis Forton décède en 1934, la série est reprise de 1936 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale par le dessinateur Gaston Callaud. Puis Pierre Lacroix reprend la série en 1947 et lui adjoint un petit compagnon noir, Razibus Zouzou, que Bibi Fricotin rencontre dans un port. Pierre Lacroix restera ensuite le seul dessinateur de Bibi Fricotin jusqu’à l’arrêt complet du titre en 19881.
Présentation des personnages
Bibi Fricotin
Bibi est un jeune homme blond, pas très grand, espiègle et très dynamique. C’est très régulièrement un redresseur de torts qui ne se laisse pas berner par les personnages malveillants ou malhonnêtes qui peuvent parfois jalonner sa route et celle de son ami Razibus. Intelligent et astucieux, il vit de multiples aventures dans le monde entier2.
Razibus Zouzou
Créé par Pierre Lacroix en 1951, Razibus est un jeune Noir africain, comparse et ami de Bibi Fricotin. Le jeune homme donne, particulièrement durant les premiers albums, une touche comique à la série, mais ces deux personnages deviennent au fil du temps inséparables et complices3. Malgré le contexte (les années 1950) et la présentation du personnage quelque peu caricaturale, voire stéréotypée (avec de grosses lèvres rouges), son langage, son attitude et ses raisonnements sont nettement plus neutres, Razibus se présentant comme un jeune homme de son temps, intelligent, loyal et courageux4.
Autres personnages
Trois personnages secondaires, mais récurrents, apparaissent dans la série5 :
- Le professeur Radar, savant, inventeur et ami de Bibi et Razibus
- L’inspecteur Martin, policier qui intervient quelquefois pour aider Bibi et Razibus
- Le professeur Trublion, savant fou, ennemi de Bibi, Razibus et du Pr Radar
- lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibi_Fricotin
Soleil bleu

Soleil bleu
Le soleil est bleu ce matin ; le jardin a une drôle de gueule. Ils disent qu’il pleut, pour me faire souffrir, je suis nouveau, ici, je suis un bizuth. Ici tout est bleu. Il faut s’y faire. Ranger ses affaires à l’ombre des grands costauds, fumer des pipe-lines, conjuguer le crime à l’imparfait et au futur, se radier. Devenir indistinct tout en restant élégant sur ce bout de chemin qui court à mes trousses, comme une ignorance sur le soleil vert. Une démarche vagabonde sur un voyage désormais immobile : la cruauté, saignée à blanc sur un spectaculaire cénotaphe orphelin de toute humanité.
Irma est encore allongée auprès de la rivière et ses pieds pendent sur la rive : la corde n’était pas assez longue, c’est pour ça qu’ils m’ont trouvé pleurant, geignant à ses pieds. La belle Irma, ange déchue,tenant son épigastre sous l’inversion de mon pilastre, dévorant la vie sous les infrastructures de mes vomissures, belle en vérité et faussaire en jupons : irions nous voir Goya ce 3 mai qui venait ?
Faire l’amour sous les trembles et sautiller sous les aulnes, danser chez Henri IV et baiser à l’ombre des volets genoveses en écoutant le chant des départures ferroviaires, innocenter les quais de ces individus en partance ; ô temps que le partage illustrait l’horizon, rien ne fuyait sur la ligne, rien ne déraillait.
Irma est morte. Je l’ai tuée. Comme le ciel est bleu ce matin, comme vos yeux.
Et ce vent doux, sans affectation, qui glisse sur mon cou, dans ce verglas lascif et incisif. Apprendre aux petits loups à manger de vieilles grand-mères sera ma rédemption. Et le soleil se coucha, sans honte aucune, aux balcons du jardin, les lèvres offertes à ce doux baiser de patience qu’organisait le Printemps.
20 01 2002
AK
Avant de fermer la porte du temps (rediff)

C’était un jour de Noël où l’on demanda au père, qui somnolait sur sa chaise pendant que les reines et les rennes banquetaient , de révéler un secret. Il faisait beau, ce qui est rare dans le petit pays dès que l’on dessert la table le givre de l’ivresse perd son goût de raisin. Une légende raconte que quand cesse la ripaille, les célestes breuvages lors d’un joyeux festin, les nains rassemblés dans la cuisine pour découper la bûche font un rot tonitruant avant de la servir, petit peuple asservi, puis se racontent cette histoire.
C’était à Newcastle Upon the Tyne. Simonette marchait devant. Léo, qui était asthmatique, portait par élégance le sac à dos de sa compagne, et soufflait, projetant de petits nuages de vapeur, de ceux que seule en génére la tendresse. La rue était pentue et de larges plaques de béton, 80×80 environ, constituait le pavage des trottoirs de ce cette rue au doux nom de « Terrace ». Ils cheminaient vers une adresse où des jeunes de leur âge squattaient un appartement, dans cette cité minière que Margaret Thatcher avait détruite, malgré les travailleurs en grève qui avaient battu le pavé durant des mois, parmi les rangées de maisons accolées sous la morne pluie de ce début de mai où logeaient encore quelques ouvriers perclus sous le ciel charbonneux de cette Angleterre perdue.
Simonette courait devant lui, listant au passage les numéros de la rue que leurs amis avaient inscrit sur un bout de papier, dans un pub enfumé. Et soudain, elle s’était mise à sautiller sur les dalles, virevoltant comme une gamine joue à la marelle dans une école ou un autre monde.
Ce fut l’instant où Léo comprit que Simonette était la femme de sa vie.
25 12 2022
AK
Lola avait sommeil…

Lola avait sommeil, alors j’ai ouvert le canapé lit. Cela faisait cinq ans que plus personne ne me rendait visite et j’eus peur de découvrir ce que le matelas avait tracé sur le passage de mes derniers invités. Non, pas d’alarme illusoire, ces derniers étaient tous repartis vivants et en forme, malgré les ébats de ces deux nuits dont une seule ne suffirait pas pour nettoyer les pièces que nous avions gaiement souillées.
Il y a cinq ans, je ne connaissais pas Lola, j’ignorais tout d’elle sauf ce prénom idiot entendu cent fois rue Poulet, dans le 18e arrondissement de Paris, quand le marché s’y déroulait le samedi matin.
Je n’ai jamais compris les femmes, et ce prénom avait une consonance assez perverse dans mes oreilles, la peur ou le frisson de l’attirance, je ne sais, mais certainement beaucoup des deux, tant la raison et la passion obèrent l’exactitude des sentiments. Tout est friable dans l’esprit d’un homme. L’objectif du hasard est de n’en avoir pas. Ce qui parfois crée la rencontre, d’autres fois le surréalisme du désir et des syncopes orgasmiques, temps variables de l’attraction terrestre et des grands-roues des fêtes foraines.
Vers dix heures du matin, j’entendis frapper à la porte :
« Monsieur Jean, s’il vous plaît, ouvrez-moi ! »
La porte était ouverte, je ne la fermais pas, du moins j’en avais perdu la clé.
De mon lit j’ai crié : « c’est ouvert, mais fermez-la à cause des courants d’air ! »
Elle était translucide, telle une femme qui aurait avalé toutes les étoiles du ciel, moche de nuit et de ruptures mais dont il fallait pour le comprendre dérouler les pans de son existence, et je n’en savais rien. Elle avait sommeil. Elle me dit qu’elle s’appelait Lola ; soudain,quittant rapidement le canapé lit, elle vînt s’engouffrer dans les draps sales de mon lit que, comme un ours, je ne lavais qu’au printemps. C’est ainsi que nous passâmes notre première nuit. Malgré les trains de la gare du Nord qui démarraient avant l’aube nous avons découvert que nous étions ravis de voir le jour se lever, et nous rîmes ensemble de nos ronflements réciproques qui laissaient s’évanouir l’attente des ouvriers en partance sur les quais dans le brouhaha de la vie.
Lola connaissait la vie et la vie quelque part l’avait oubliée dans un de ces halls de gare, puis sur les quais infâmes du Havre et d’autres ports lointains.
Mais que valait ce matin-là deux solitudes collées l’une contre l’autre dans le fatras d’un monde en capilotade ? Et ce prénom stupide qui tintait dans mon cœur comme auparavant je l’avais trouvé ridicule et péjoratif ? Et moi, Jean, ne portais-je pas un prénom aussi ridicule pour un homme de mon âge ?
Dans quel épouvantable marécage où nous commencions à nous engluer, non par nos prénoms qui prêtaient à confusion pour Lola et à l’uniformité pour moi. Le grand sommeil faisait son lit dans une irréversible parodie de vie, et cette vie devenait commune alors que nous restions l’un et l’autre différents, par le sens de nos désirs et la faiblesse de nos échanges. Lola avait sommeil et je lui ai ouvert les bras comme un début d’aventure s’inscrit sur un chemin dont on ignore les risques et l’état de fatigue qui peut nous surprendre à tout moment. Quand un rire se soumet et qu’un pleur se sent par malchance bienheureux l’union devient la meilleure trajectoire pour ce chemin qui s’ouvre, comme un canapé lit.
27 11 2024
AK
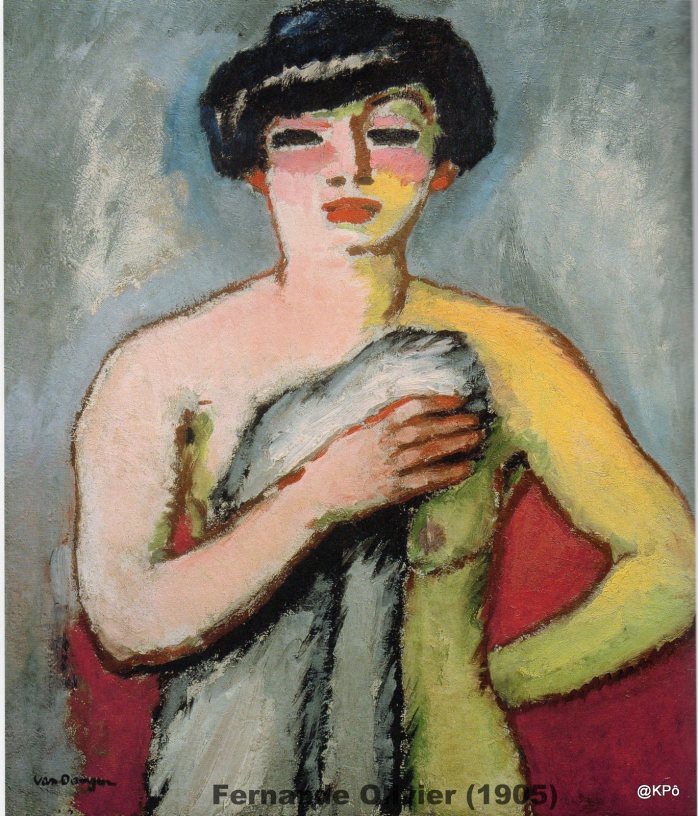
J’irai dormir dans le creux des étoiles mortes

Ce soir j’irai m’assoupir comme une ombre
Sur l’écorce rude d’un arbre, le palperai
Tel un aveugle sur les chemins de Compostelle
N’écoutant que les bruits de mon ventre et le vent
De Galice en automne, le chant des loups,
Le bêlement des moutons dans les prairies
Ce soir je partagerai les rires des bergers
Ceux qui ne dorment jamais, éternels éleveurs
D’âmes qui n’ont pour dieu que le climat,
Et quelque part une bergère sur une couche
Rudimentaire hurlera à l’amour, louve exemplaire
D’un monde où l’homme et les brebis paissent
Dorment sous le même toit, ronflent et pètent
Quand l’orage en furie se tait sous leurs soufflets
Que l’éclair qui jaillit embrase la nuit glaciale
J’irai dormir dans le creux des étoiles mortes
Brillantes comme des plaies ouvertes sur l’abandon
Sur ce drame que l’homme inflige à son prochain
Par vanité par puissance illusoire, par l’histoire
Qu’apprennent dans les écoles les gamins sans enfance
Et sur l’écorce rude d’un arbre aveugle et centenaire
Je graverai ton cœur, ô bergère de Compostelle.
15 12 2024
AK
Un tour au Pays Basque avec Chillida

Pour me simplifier la vie, je recopie ce qu’en dit wikipédia, qui en sait plus long que moi.
Visite du parc où sont exposées certaines de ses œuvres, à Hernani, côté espagnol du pays Basque.
Après un temps d’arrêt dû au manque de fréquentation et de lourdes dettes de fonctionnement, le parc à réouvert par la reprise effectuée par une société suisse qui désormais gère l’espace du lieu (« leku » en basque).
Wikipedia : Ses œuvres, sculptures, dessins, gravures, livres illustrés, font partie des grandes collections privées et publiques à travers le monde. Le musée Chillida (es), à Hernani, près de Saint-Sébastien, abrite une quarantaine d’œuvres dans un espace en plein air au sein d’une propriété du XVIe siècle. Fermé au public depuis le 1er janvier 2011, il est rouvert le 17 avril 20194.
Eduardo Chillida naît le 10 janvier 1924 à Saint-Sébastien, dans le pays basque espagnol.
Avant de devenir artiste, Eduardo Chillida est gardien de but de la Real Sociedad. À cause d’une blessure aux ménisques, il doit mettre un terme à sa carrière1.
De 1943 à 1947, Eduardo Chillida étudie l’architecture à Madrid. En 1947, il abandonne l’architecture et fréquente l’Académie des Beaux-Arts à Madrid. Il décide alors de se consacrer à la sculpture et expose à Paris dès le début des années 1950 (première exposition en 1949 au Salon de mai), et s’installe au Pavillon espagnol de la Cité universitaire. Il y fait la connaissance de Brâncuși et des peintres et sculpteurs espagnols Antoni Tàpies, Marino di Teana, Xavier Oriach, Baltasar Lobo, Ginés Parra, Orlando Pelayo, et Pablo Palazuelo. Cette même année, il retourne à Saint-Sébastien pour y épouser Pili de Belzunce et participe à une exposition collective à la galerie Maeght. En 1951, il fait sa première sculpture en fer, Ilarik, installée à Saint-Sébastien.
En 1954, il fait sa première exposition personnelle à la Galerie Clan, à Madrid. Cette même année, il sculpte les portes en bas-relief de la basilique des moines franciscains d’Arantzazu. En 1955, il exécute une sculpture en pierre pour commémorer Sir Alexander Fleming à Saint-Sébastien. En 1956, a lieu sa première grande exposition à la Galerie Maeght, Paris, et devient un des artistes de la Galerie. En 1958, il expose au Pavillon espagnol à la Biennale de Venise, et fait son premier voyage aux États-Unis, où il participe à une exposition au musée Solomon R. Guggenheim, et au Pittsburgh Museum of Art, Carnegie Institution. Il reçoit le prix de la fondation Graham, ainsi que le prix Kandinsky par Nina Kandinsky en 1961. En 1962, il fait une exposition personnelle au Kunsthalle de Bâle et participe à l’exposition « Trois espagnols : Picasso, Miró, Chillida » du musée des beaux-arts de Houston. En 1964, il expose une fois encore à la Galerie Maeght, reçoit le prix Carnegie pour la sculpture au Pittsburgh International et participe à une exposition collective à la galerie Tate. En 1965, il expose à la galerie Mc Roberts and Tunnard, Londres. (…/…)
Quelques photos du site :

















Les mardis de la poésie : Nazim Hikmet (1902-1963)

Don Quichotte
par Nazim Hikmet
Le chevalier de l’éternelle jeunesse
Suivit, vers la cinquantaine,
La raison qui battait dans son coeur.
Il partit un beau matin de juillet
Pour conquérir le beau, le vrai et le juste.
Devant lui c’était le monde
Avec ses géants absurdes et abjects
Et sous lui c’était la Rossinante
Triste et héroïque.
Je sais,
Une fois qu’on tombe dans cette passion
Et qu’on a un coeur d’un poids respectable
Il n’y a rien à faire, mon Don Quichotte, rien à faire,
Il faut se battre avec les moulins à vent.
Tu as raison,
Dulcinée est la plus belle femme du monde,
Bien sûr qu’il fallait crier cela
à la figure des petits marchands de rien du tout,
Bien sûr qu’ils devaient se jeter sur toi
Et te rouer de coups,
Mais tu es l’invincible chevalier de la soif
Tu continueras à vivre comme une flamme
Dans ta lourde coquille de fer
Et Dulcinée sera chaque jour plus belle.
La Petite Fille
C’est moi qui frappe aux portes,
Aux portes, l’une après l’autre.
Je suis invisible à vos yeux.
Les morts sont invisibles.
Morte à Hiroshima
Il y a plus de dix ans,
Je suis une petite fille de sept ans.
Les enfants morts ne grandissent pas.
Mes cheveux tout d’abord ont pris feu,
Mes yeux ont brûlés, se sont calcinés.
Soudain je fus réduite en une poignée de cendres,
Mes cendres se sont éparpillées au vent.
Pour ce qui est de moi,
Je ne vous demande rien :
Il ne saurait manger, même des bonbons,
L’enfant qui comme du papier a brûlé.
Je frappe à votre porte, oncle, tante :
Une signature. Que l’on ne tue pas les enfants
Et qu’ils puissent aussi manger des bonbons.
Les Ennemis
par Nazim Hikmet
Ils sont les ennemis de l’espoir ma bien-aimée
De l’eau qui ruisselle, de l’arbre à la saison des fruits,
de la vie qui pousse et s’épanouit.
Car leur front marqué du sceau de la mort,
– dent pourrie, chair décomposée –
ils vont disparaître à jamais.
Et bien, sûr ma bien-aimée, bien sûr,
Sans maître et sans esclaves
Ce beau pays deviendra un jardin fraternel!
Et dans ce beau pays la liberté
Ira de long en large
Magnifiquement vêtue
de son bleu de travail.
Ils sont les ennemis de Redjeb, tisserand à Brousse,
Les ennemis de Hassan, ajusteur à l’usine de Karabuk,
Les ennemis de la vielle Hatdjen , la paysanne pauvre,
Les ennemis de Suleyman, l’ouvrier agricole,
Les ennemis de l’homme que je suis, que tu es,
Les ennemis de l’homme qui pense.
Mais la patrie est la maison de ces gens-là,
Ils sont donc ennemis de la patrie, ma bien-aimée.
Nos bras sont des branches chargées de fruits,
L’ennemi les secoue, l’ennemi nous secoue jour et nuit,
Et pour nous dépouiller plus facilement, plus tranquillement,
Il ne met plus la chaîne à nos pieds,
Mais à la racine même de nos têtes, ma bien-aimée.
Biographie (voir le site) : « https://www.poemes.co/nazim-hikmet.html
Nazim Hikmet, (Thessalonique, 15 janvier 1902 – Moscou, 3 juin 1963) était un poète, dramaturge et écrivain turc naturalisé polonais. Qualifié de « communiste romantique » ou de « révolutionnaire romantique », il est considéré comme l’un des poètes turcs les plus importants de l’ère moderne. En 1938, un de ses poèmes est accusé d’inciter les marins à la révolte ; arrêté et jugé, il a été condamné à 28 ans et 4 mois de prison pour ses activités contre le régime, ses idées communistes et ses initiatives internationales anti-nazies et anti-franquistes.(…/…)

La nuit, je vends (mon ventre).

La nuit, quand je me souviens d’être à peine à moitié ivre,
Je relis ma vie dans les feuillets d’un de ces vieux livres
Qui raconte une histoire incertaine que je n’ai pas suivie
Le temps n’est pas maudit mais tous les maux sont dits
Mon unique plaisir est encore de lire entre les lignes
Bien que mes mains soient froides quand le feu charbonne
Les derniers cahiers de l’enfance et les calcine en joie
Ces feuilles écrites que les flammes de ma jeunesse
Vomissent encore alors que je ne suis qu’à moitié ivre
Combien de hasards nocturnes ont traversé ces pages
Le crépuscule seul saura les compter, ultime opuscule
D’une vie désordonnée, suite royale d’existence plurielle
La nuit, quand je me souviens d’être à peine à moitié ivre,
L’autre aspect du néant ses fragments éloquents, ses vivres
Qui nourrissent l’histoire d’infernaux appétits boulimiques
Sous la couverture de ce livre si vieux en fait je m’endors
Et mes ongles souillés de boue alors ouvrent le firmament
Et la porte céleste n’a plus besoin de clé pour ce paradis
Je suis l’archange, je suis la banque, mon coffre est fort
Le temps n’est pas maudit les shérifs sont partis jouer
Dans les tripots de Floride où ils vomissent mon destin
En buvant du Bourbon, cette salive dorée sur les lèvres
Qui dégouline de leurs palais, de leurs dents blanches
Comme les pages de ce vieux livre à la couverture sale
Qui enveloppe ma vie, quand je me souviens à peine
D’avoir franchi le cap sans espérance de la vieillesse
Une nuit où je lisais les lignes de mes mains caleuses
Y cherchant du whisky pour lécher le sourire d’une femme
L’autre aspect du néant ses fragrances éloquentes, son rire
Comme une soupe chaude versée à l’auberge du bonheur
La nuit, quand je me souviens d’être à peine à moitié ivre,
Je relie ma vie à toutes les feuilles mortes que le vent délivre
Pour en faire un récit, ultime opuscule d’une vieillesse
Qui raconte une histoire incertaine que je n’ai pas suivie.
07 12 2024
AK
Les mardis de la poésie : Michel Leiris (1901-1990)

Poésie ?
par Michel Leiris
Cette chose sans nom
d’entre rire et sanglot
qui bouge en nous,
qu’il faut tirer de nous
et qui,
diamant de nos années
après le sommeil de bois mort,
constellera le blanc du papier.
Age des Cœurs
Le bel âge des vacances
L’âge des croisées ouvertes des pores illuminés par le bain
L’âge des cœurs sans lest autre que le sable mouillé à chaque battement de marée sculpté en château-fort
Le bel âge de sable
à chaque seconde illuminé par la marée
allégé par le bain
L’âge des cœurs ouverts
que ne grave ni ne mouille
l’eau-forte d’aucun remords
L’âge du sable répandu
à profusion
par les créneaux du château-fort
L’âge des cœurs
que la mer sculpte grain par grain.
Corruption
Les hommes
torturés dans leurs corps
et pourris jusque dans leurs mots
dont tant sont aujourd’hui déviés
de leur pôle naturel
Les choses
vidées de leur contenu
et devenues oripeaux
de la puante comédie
où le monde sue sang et eau
Le son singeant le pain
le bois changé en laine
la couleur rouge en vin
alors que le sang blêmit sur les murs des prisons
ou brunit en se mêlant à la boue
La terre prise pour tanière
la lumière obscurcie
la femme faite nuée de larmes
et l’homme mué en pierre
dont chaque jour comme chaque nuit accroissent le silence
Faudra-t-il
ô victimes
être à votre tour bourreaux
pour rendre à leur destin les essences?
Poèmes titrés du site : https://www.poemes.co/
Biographie : Michel Leiris est né le 20 avril 1901 au sein d’une famille bourgeoise cultivée habitant au 41, rue d’Auteuil dans le 16e arrondissement de Paris. Sa famille le pousse contre son gré à faire des études de chimie alors qu’il est attiré par l’art et l’écriture. Il fréquente les milieux artistiques après 1918, notamment les surréalistes jusqu’en 1929. Il se lie d’amitié avec Max Jacob, André Masson, Picasso, etc. Son œuvre a marqué les recherches ethnographiques et ethnologiques.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Leiris









Commentaires récents