le petit karouge illustré
les babillages de Chinette, les coloriages de Chinou
Les petits faits d’hiver amusants parus dans la Presse (Ouest France)

Article à lire dans Ouest France
Confinés mais heureux. Soixante personnes venues assister à un concert dans un pub du nord de l’Angleterre, vendredi 26 novembre 2021, ont été surprises par la tempête Arwen et sont restées bloquées sur place trois jours et trois nuits. Au lieu de se lamenter sur leur sort, ces clients en ont profité pour passer du bon temps, notamment en organisant des soirées karaoké.
°°°°°°°

Une chronique de Xavier Mauduit, qui n’a rien à voir, mais vraiment surprenante historiquement !
https://www.arte.tv/fr/videos/106792-005-A/une-replique-de-paris-pour-tromper-l-ennemi-en-1918/

encore un truc qui n’a rien à voir !
Un cavalier qui surgit pour nous plonger dans la nuit : Z.

Paroles détournées de la chanson L’ami Zantrop par Boby Lapointe
Moi j’connais un ennemi il s’appelle Éric
C’est son nom Éric
Nous, on l’appel’ Zemmour c’est not’ ennemi Zemmour
Bonjour l’ennemi Zemmour
Quand il est à Marseille il vit comme un ascète
I’ sort jamais là-bas
Mais quand il est à sec i’ vit comme à Paris
Toute la nuit i’ sort
I’ fait le tour des libraires où il signe ses livres
Il délivre la France des envahisseurs
Y’en a plusieurs à Paris
Il cherche Marine le Pen sa doudou fiancée A vu
Marine ? pas là
A la fin il la trouve il lui dit ce qu’il pense
L’est pas content tu sais
Il dit fuyons ces libraires de métèques qu’ont pas voulu
Que je paraphe mon torche cul
Ah ! parce que c’est son mot ça
Parce que lui il dit que ceux
Qui peuvent parapher dans ces librairies i’ sont affreux
Et quand ils s’arrêtent de signer leurs bouquins
Il dit c’est des boîtes de laids-braire, des morveux !
Et voilà ! ça fait rigoler
Ah la la ! Oh bon pas trop
Mais lui il est en colère
Et il dit en grinçant des molières
Moi j’ai un majeur qui fait tout mon honneur
Et l’art de te le mettre profond et sans douceur
Puis i’reprend son souffle se récite Molière
Non je ne puis souffrir cette lâche méthode
Ah il aim’ pas
Qu’affectent vos gens de la rue et comment ils la tordent
II aim’ pas la rue, c’est pas son mode de vie
Et je ne hais rien tant que les contorsions
De ces négresses qu’on met au Panthéon
Il aime pas les prises de conscience aux couleurs arc en ciel
Il préfère les blancs becs
De tous vos grands faiseurs de protestations
ll aime pas du tout
Viens viens ma petite Le Pen ! Ah viens viens je
t’amène Allez viens va
Laisses ces sapajous faire ensemble joujou
lls pensent égalité des sexes et dansent
Toutes leurs flatteries et leur cajoleries
Avec les mains
C’est rien que du chiquet et de la crot’ de biquet
Ah ça c’est son mot encore
Parce que lui il pense pour l’amour c’est travail famille patrie
Pas besoin de faire des discours
Lui tout de suite allez : « votez Zemmour »
Et voilà c’est pas compliqué
Mais Marine c’est pas ça du tout
Elle veut pas tout de suite « Boum Boum la démocratie »
Pas que ell’ c’est un’ grand coquette
Et puis d’ailleurs tu vas voir les sondages
On en discute après, gringalet!
Mais notre petite Le Pen dit pas toujours amène-toi, non
Oh non
Au contraire bien souvent elle dit Ah mais non
C’est vrai ça t’as vu ta quéquette ?
« Moi j’aime conversation de garçon plus amen
Amen signifie doux
Et du côté oreilles en feuilles de choux
Je préfère encore celles de Bayrou
Puis j’suis pas comme Marion je rent’ pas à minuit
Si tu crois que pour Zemmour y a pas besoin de Pétain
De péter sur le père de pétards pour la mère
Vas donc chercher ailleurs qui peut faire ton
bonheur
Pour gagner une guerre il faut faire des manœuvres
Mets d’autres mensonges sur tes lèvres et de maux sur ta fièvre
Si tu veux finir ministre de la Culture française »
Eh bien voilà ! Tout ça c’est de la diatribe…
Elle est comme ça Marine…
Elle aime avoir beaucoup d’amoureux
Qui font « Nanana » des manières
Oh oui mais tout ça c’est bien triste
Et ça donne envie de partir
« Et chercher sur la terre un endroit écarté
Où d’être homme d’honneur on ait la liberté »
Comme il a dit un copain à moi
Seulement voilà y en a pas
Tout est loué depuis Pâques
Et jusqu’aux élections
Alors qu’est-ce que tu veux faire ?
Ben, moi je préfère écouter Boby Lapointe !
Paroles originales ici : https://www.paroles.net/boby-lapointe/paroles-l-ami-zantrop
Mini croisière sur la Meuse avec vues sur l’ère post-industrielle wallonne

Photos prises en juillet 2021. (entre Visé et Monsin, en direction de Liège)
























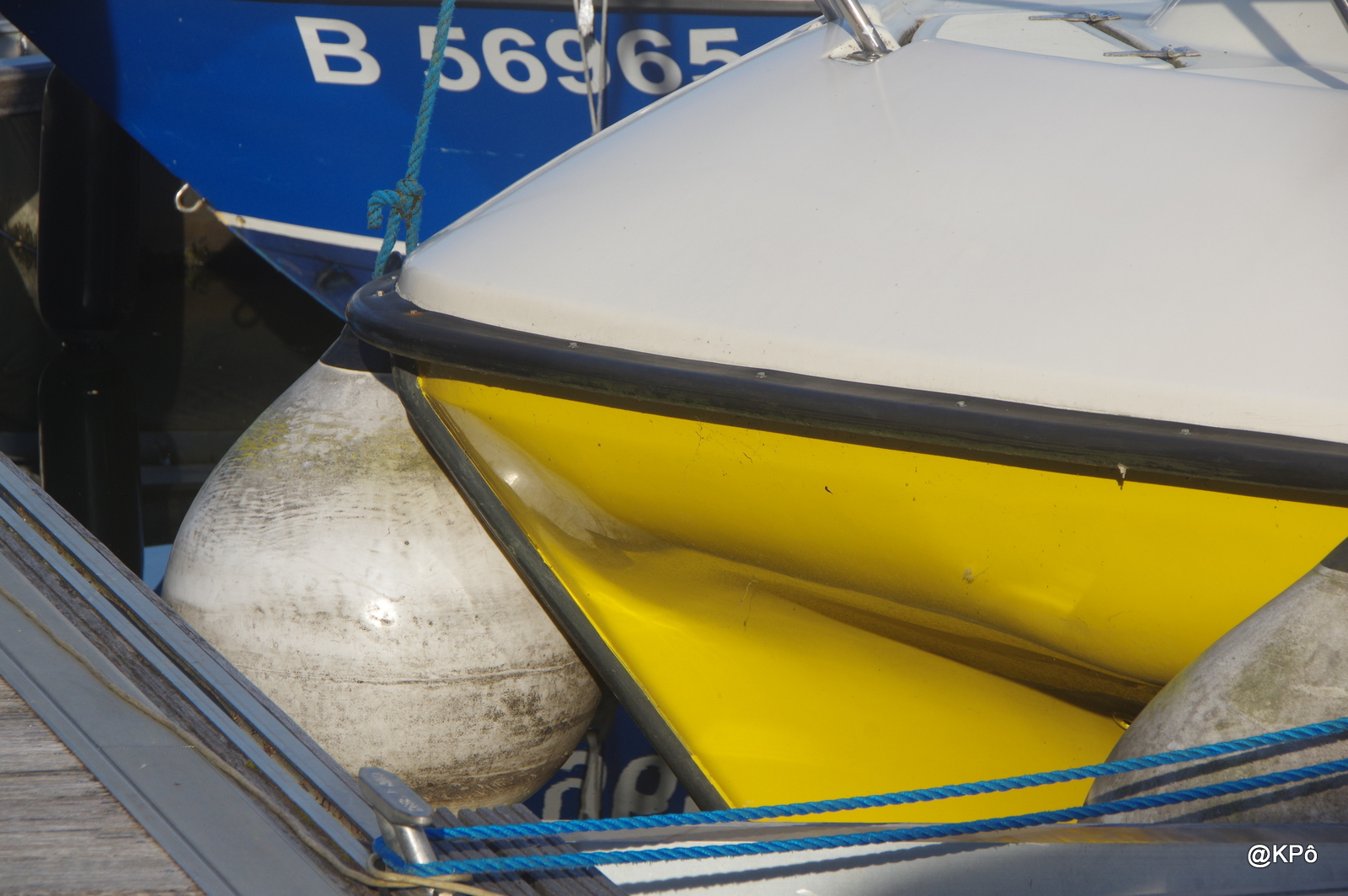
Jour d’asphalte (26)

« – Ça suffit, merde, John ! Arrête de me chicaner dans les virages bon sang, regarde ! T’as dévié le rétroviseur ! »
Mes nerfs se rebellent sous ma peau, alors que d’un geste maladroit John détourne de nouveau le rétro. Un silence soudain s’instaure. Je regarde vivement John. Il s’est figé : marmoréen, il articule avec difficulté :
« – Rudolf, vite, rétrograde ! Sa voix reprend tout à coup sa puissance coutumière. Tu vas nous tuer, ralentis ! Tu abordes le virage trop vite, merde ! »
Il s’accroche à moi, tente par tous les moyens de saisir le volant, les pédales, le frein à main. Je l’en empêche du mieux possible, salaud ! Traître ! Des coups de poing et de pieds fusent, voltigent dans l’air assombri du crépuscule.
« –Rudolf ?
« -… »
(fin de la première partie)
Deuxième partie
Un petit fascicule d’histoires courtes écorné, graisseux, traîne sur le sol, ouvert à la page soixante treize. Pour peu que le regard s’y prête, il tombera sur ces quelques lignes :
« Elle dit le temps jaillit les gouttes de sang aussi
« Mais mon arcade sourcilière blessée lui bâtit un palais
« Au cinquième round sans ascenseur l’uppercut est dans l’escalier
« Elle dit c’est le dernier le souffle aussi écrase ses mâchoires
« Sur la réalité d’un contre gauche ma jolie
« Au sixième round les valises sont prêtes pour l’hématome amoureux
« Elle dit laisse le gong, attaque, mais je suis si sonné
« Que d’ici peu toute la robinetterie va éclater
« Au septième round l’ange Gabriel crache au bassinet
« Pour un cachet c’est un sale pacson que j’ai palpé
« Elle dit je veux plus te voir pauvre dégonflé
« Et elle se barre, la vie, avec toutes les liquidités
« De mon arcade sourcilière blessée. »
Le commentateur :
« La cloche sonne pour la huitième reprise. La salle exulte. Les travées sont jonchées de bouteilles vides et de mégots fumants éclos du sol bétonné. Rudolf Steiner et John l’Immigré sont de nouveau face à face, poings en protection au niveau du plexus, ils gravitent l’un autour de l’autre, tantôt lune tantôt soleil, reliés par des navettes de cuir qui assurent l’alternance de leur suprématie. Magnifique swing de John qui soulève les hourras de ses supporters, auxquels succède une contre attaque serrée de hurlements, voix de crécelles et vomissements divers de l’autre partie. Toute l’assistance est en délire, brassant l’épaisse tabagie qui stagne autour des projecteurs fixés au-dessus du ring. Une foule bigarrée s’est juchée sur les petits sièges en bois des gradins et houspille à qui mieux mieux les deux belligérants. Crochet du droit de Rudolf accrochant le menton en sueur de John, qui contre par un direct, esquivé de justesse par Rudolf dont le cross vient frôler la tempe de John. La foule trépigne. Homérique combat ! Il y a un tel brouhaha dans la salle que je commence à avoir quelques difficultés à m’entendre parler dans le micro. Des bagarres sporadiques éclatent ici et là, des canettes vides voltigent dans l’air lourd. La cloche tinte. Fin du huitième round. Un tabouret est vivement glissé entre les cordes par les soigneurs munis d’un seau d’eau et d’une éponge.
Installé sur le siège, gants posés de part et d’autre sur les cordes formant un angle droit, chaque combattant crache son râtelier dans les mains d’un soigneur, se rince le gosier d’une gorgée d’eau qu’il recrache, s’essuie le visage avec une grande serviette, la même qu’avait Beau Gosse dans le bus se souvient Rudolf, se frotte avec un peu de crème cicatrisante. Encore dix secondes avant la reprise. Gong. Neuvième symphonie. L’hymne à la joie résonne dans les gradins, des spectateurs s’empoignent, élargissant par une magie ubiquiste le pugilat de l’arène centrale. Hélas le bruit est maintenant tel que la retransmission devient inaudible. On me fait signe qu’un fil a été arraché, petit problème technique, mon micro est réduit en charpie, je vous rends l’antenne momentanément, à vous les studios! »
« -Venez par ici docteur ! Le souffle court de celui-ci recèle encore un soupçon de vie. Quelle hécatombe ! Il y a des corps partout !
« -Une véritable diaspora Ernestine, il faut lui faire une perfusion au plus vite. N’oubliez pas de prendre une fiole pleine, contrairement à la dernière fois, hein ? »
Le corps gracile, moulé à la louche comme disent les normands, d’Ernestine se faufile parmi les sirènes, les clameurs et les injonctions imparfaites de la spectaculaire lutte qui se déroule à la nuit tombante. D’énormes projecteurs illuminent la scène du drame, accompagnés parfois d’un rai bleu de gyrophare devant lequel file furtivement un personnage au front dégoulinant de sueur verte. Les trous de mémoire se terrent dans les plus obscures ailes de ce lieu théâtral où le drame prend corps.
AK
Jour d’asphalte (25)

C’est l’instinct des petites bourgades qui conservent leur mémoire en ne déplaçant rien de leur ancienne prospérité. John asperge involontairement quelques chalands benoîts en bordure des quais, avant de stopper le véhicule une dizaine de mètres plus loin., en face du bureau des messageries. Un gros bonhomme, qui doit faire office de lanterne signalétique vu sa rougeur extrême, se plante devant la portière avant du bus. Les vêtements qui collent à son corps comme une doublure de film comique désigne formellement l’une des victimes de John.
Celui-ci se décolle de son siège, ouvre la portière et descend en sifflotant, inconscient des dégâts qu’il a occasionnés. L’homme, évaluant la carrure de John, se ravise instantanément, grommelle deux secondes dans un jargon spécialement ardu, mélange d’écossais et de finnois, puis disparaît, se liquéfie dans la grisaille alentour. John regrimpe la première marche du bus, et saisit sur le siège avant une serviette éponge bicolore dont il recouvre ses épaules. Il se dirige ensuite en sautillant vers l’antre poussiéreuse que masque un panonceau en fer blanc sur lequel s’inscrit le mot réception. La porte vitrée tintinnabule de tous ses grelots exotiques sous l’impulsion de John. De l’air frais s’engouffre par la portière ouverte du Pullman,, renouvelant l’atmosphère lourde et ensommeillée qui règne dans l’habitacle. Je m’installe aux commandes pendant qu’il revient, après avoir claqué la porte des messageries avec un mélange d’enthousiasme et de fureur. Juste le temps d’ouvrir et refermer la porte à soufflets, et nous repartons.
« – Rien pour nous ! S’exclame-t-il en se vautrant sur la banquette avant. L’horloge du tableau de bord indique seize heures dix. Des panneaux indiquant Roccalito fleurissent à chaque coin de rue, germinations précoces dues aux abondantes pluies qui jonchent le macadam. Nous re-franchissons la porte saint Martin et obliquons vers la gauche. Roccalito, cent vingt kilomètres. La route dégringole maintenant vers le niveau de la mer en serpentant sous un ciel bas, qui semble avoir délaissé pour l’éternité l’orage qui enveloppe à présent la citadelle. Temps maussade, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur du véhicule où je lorgne en grimaçant l’apathie générale des voyageurs, de John. Figurines de cire peintes de fatigue, la vie ignore ces marionnettes défraîchies qui hantent mon théâtre. Je connais à présent tous les individus que je transporte.
Dehors, la route franchit une multitude de petits ponts en pierres aux coloris cendreux, qui contraste avec l’eau écumante des cascades, qui semblent chuter directement des nuages tant le brouillard est épais. Des conifères plantés par la main humaine déguisent parfois en orgues gigantesques les collines escarpées, découpant leurs silhouettes de tuyaux ventrus. Des mousses rougeoyantes courent le long des des blocs erratiques, d’immenses champs de myrtilles éclairent de leurs tons purpurins les reliefs venteux des cols que nous franchissons l’un après l’autre. La route sinue, insidieuse malgré sa chatouillante bonhomie de caresseuse mondaine. Altitude bloquée dans mes oreilles qui changent d’octave, et ce silence qui gémit pour qu’on le laisse en paix, la tension maîtrisée par les contreforts d’une nourrice éthérée qui exacerbe sa nudité minérale et ventripotente en quatre dimensions de risques ; boucles bitumées qui ondulent et enlacent le spectaculaire immobilisme pluri-millénaire pour n’en extraire qu’une grandiose lascivité des sens. La montagne nous contemple nous, reptiles bruyants qui ne possédons plus de l’instinct que cette modalité linéaire balisée, comptabilisée, rentable. Un morceau de la serviette éponge de John placée sur le dossier de la banquette se flanque sur son front, le réveillant en sursaut.
« – Hein ? Ho ? » s’exclame-t-il en bondissant du siège, ce qui déclenche mon rire.
« – Tu ne tiens plus la distance, Beau Gosse ! Il est temps que tu jettes l’éponge !
« – Parle pour toi, vieux, j’ai une frite exceptionnelle rien qu’à l’idée de ce que je vais faire ce soir, quand on sera arrivés !
« – Encore des conneries ! Moi ce soir j’ai prévu d’aller à un combat de boxe. C’est devenu assez rare de par chez nous et je ne voudrais pas rater ça !
« – Mais tu as une sacrée idée, là ! Surtout que la boxe, ça me connaît ! Avant de pratiquer la voile mon meilleur pote était un putching-ball tout de cuir vêtu. »- A l’époque tu cherchais déjà un coq pour lui voler dans les plumes, ouais ! »
John sautille à mon côté, échauffé par l’idée d’une participation physique au pugilat de ce soir. Il s’amuse à balancer des coups dans ma direction, faisant saillir biceps et pectoraux de son T-shirt moulant.
« – Regarde-moi ce jeu de jambes, cette allonge, plaf plaf !
« – Calme-toi, John.
« – Une vraie danse tribale dans la jungle du ring que j’offrirais à mes sparring partners, si je montais là-haut ! Les cordes, mec, je les laisse à Tarzan ! »
John s’excite de plus belle, sous l’œil pantois de quelques passagers qui cèdent peu à peu à l’inquiétude l’amusement fourni par ce grand singe.
« – Ça suffit, merde, John ! Rrête de me chicaner dans les virages bon sang, regarde ! T’as dévié le rétroviseur ! »
Mes berfs se rebellent sous ma peau, alors que d’un geste maladroit John détourne de nouveau le rétro. Un silence soudain s’instaure. Je regarde vivement John. Il s’est figé : marmoréen, il articule avec difficulté :
« – Rudolf, vite, rétrograde ! Sa voix reprend tout à coup sa puissance coutumière. Tu vas nous tuer, ralentis ! Tu abordes le virage trop vite, merde ! »
Il s’accroche à moi, tente par tous les moyens de saisir le volant, les pédales, le frein à main. Je l’en empêche du mieux possible, salaud ! Traître ! Des coups de poing et de pieds fusent, voltigent dans l’air assombri du crépuscule.
« -Rudolf ?
« -… »
(fin de la première partie)
AK
Vingt sept vingt huit vingt neuf…etc

Ce soir la nuit est tombée à cinq heures. Il n’y avait pas encore de morts, juste des doigts gelés. Les enfants les suçaient, blottis entre les seins gonflés de leurs mères enceintes. Sur cette mer, noire, où naviguent les naufragés, dans l’étrange écume d’un gâteau savoureux ourlé de crème fraîche anglaise, le mirage d’un château de sable sur la plage d’en face, au pied de ces falaises blanches comme la craie, qui contrastaient tant avec la couleur de nos peaux, si accordées pourtant à celle de la mer, étroite et froide comme l’inattendu, poissons pris dans les filets dans lesquels la faim, la guerre et la misère nous avaient plongées, un jour gris de novembre. Traverser. Traverser ce minuscule désert marin, nous qui avions parcouru des milliers de kilomètres, soumis aux bandits, aux marchands d’illusions, les falaises de craie que nous voyions face à nous, crayons friables sur les tableaux noirs comme nous écrivant avec passion notre nouvelle vie.
La nuit est tombée à cinq heures. Soir ou matin, je ne sais plus. Il pleuvait, il faisait nuit. Je dormais à peine et celui qui m’a réveillé a simplement dit : « c’est l’heure. »Combien étions-nous dans cette embarcation, je l’ignore. Je suis ingénieur, dans mon pays, mais ici j’ai perdu toutes mes facultés à assumer le rôle et les capacités intellectuelles que j’avais cumulées. Mon seul savoir, c’est survivre. Mon seul savoir, c’est revivre. Mon seul savoir c’est vivre. Ensuite, petit à petit, dans ce monde impossible, reconstruire. Reconstruire un bonheur sur les pierres du malheur. Voir les fleurs pousser de nouveau dans mon jardin, les enfants rire et aller à l’école, dormir avec Yasmina dans le même lit, là d’où je viens,où je voudrais retourner quand tout s’apaisera, mais quand, dis-moi, quand, qu’en sais-je aujourd’hui, que sais-je de demain ?
La nuit se tait, le canot est plein, qui rase l’eau, les premières vagues sans écume, sans bave. Langues de mer trompeuses, rivage plein d’enthousiasme. J’ai pensé à mon père. Lui aussi s’embarquait. Pour aller faire la guerre. On l’y avait contraint, mais il avait sauté dans le bateau en espérant gagner de quoi faire vivre décemment sa famille plus tard, avec le solde et la pension. Au débarquement en Sicile il perdit la vie. Personne ne se souvient de lui. Méditerranée. Moi je navigue sur la Manche, et comme il pleut, c’est con (Allain Leprest), cette pluie inutile qui tombe, le dimanche, sur la Manche.
C’est con. C’est con d’aller mourir sur la Manche, un jour de pluie de novembre. Et puis, je ne voudrais pas dire en m’embarquant sur ce rafiot, que toute cette misère, ces guerres et ces massacres, maintenant que je sens que la noyade sera mon proche destin, comment pourrais-je le dire, dans le silence des eaux sous-marines, sinon en évoquant les traces toujours cruelles de la colonisation, des frontières créées à coups de cordeaux sur des territoires multi-ethniques, et surtout par la corruption que l’Occident, en les perdant, y a laissé demeurer ceux qui encore les servent. Mais depuis, la corruption s’est infiltrée dans le corps même des pays qui ont bien compris la leçon et en usent à foison.
Alors ce soir, il doit être vingt deux heures, les falaises de Douvres blanches comme des craies, n’écriront pas mon histoire, mais celle certainement de milliers d’autres…
AK
26 11 2021
Jour d’asphalte (24)

Il y eut ce soir-là un grand remue-ménage au bar des « Bons Amis ». Chacun y allait de sa tournée, de ses encouragements, non pas à grands cris, mais par une phrase glissée à mon oreille, une tape amicale sur l’épaule, un clin d’œil appuyé, un sourire complice. La perfidie à cœur ouvert, visible, à fleur de peau, l’épicier, Jean Jacques,, la tenancière et tous les autres présents, tous suaient la médiocrité. Spectacle insupportable que j’aurais fui à l’instant si je n’avais pas été décidé à mener jusqu’au bout mon scénario. Je stipulais à mes congénères que la date de la visite n’était point fixée et que, pour qu’elle ne parut pas intéressée, j’irai chez monsieur Jügg un jour de semaine, lorsque chacun est occupé à sa besogne. Je connaissais déjà le motif fallacieux qui me permettrait d’aller frapper chez l’homme, mais nul ne devait le savoir. Tous approuvèrent. Nous trinquâmes une dernière fois, puis je regagnais mes pénates.
Deux semaines s’écoulèrent durant lesquelles l’agitation retomba. Je croisais Jean Jacques à plusieurs reprises dans la rue mais nous parlâmes de choses et d’autres. Son œil inquisiteur cherchait bien entre mes lèvres un mot, un malaise corporel, la primeur d’une révélation, mais je le laissais sur sa faim. Il avait de mauvaises moues quand mes réponses ne le satisfaisaient pas, ou que le sujet lui paraissait banal comparé à l’événement qui se tramait. Je me réjouis intérieurement de son attitude, car il semblait lui-même avoir vu le diable en personne, tant il s’agitait et balançait ses bras dans tous les sens. Au café, la bistrotière me prenait par le bras et, approchant sa bouche fine de mes oreilles, me glissait « regardez bien ses cicatrices sur son front ! ». L’épicier penchait plutôt pour l’observation du contenu des lieux, à savoir la présence de quelques louis d’or traînant sur la table, ou d’un coffre malencontreusement entrouvert où j’eusse pu voir un amoncellement de bijoux. Tous voulaient que je leur ramenasse cette part d’eux-mêmes qui faisait travailler leur cervelle, cet aspect de l’individu qu’ils n’avaient jamais soupçonné être leur, par le simple apport d’une ouverture d’esprit , d’une compréhension, de l’empathie prodiguée à son prochain. Ils voulaient que je leur accordasse leur propre dégoût. Telle était ma véritable mission.
Le troisième vendredi suivant ma résolution publique je pénétrai à l’intérieur du bistrot. Je vis vaguement dans la grande glace du comptoir que mon visage était livide. Le silence s’instaura jusque dans la rue. Tous étaient pétrifiés, leurs yeux vissés sur moi. La patronne fut la première à réagir. Elle me servit un bock de bière avant d’exprimer un alors ? mal assuré. D’une voix caverneuse, toujours devant l’assemblée pétrifiée, je répondis : « Ça y est. J’en sors. » Les regards me transpercèrent, à la fois terrorisés et quémandeurs. Ils touchaient enfin au but, ils allaient voir leur misère devant leurs yeux, là, émise par ma bouche comme une sentence, un couperet qui allait trancher leur corps en deux ; je jouis profondément de cet instant de silence total, moi, l’étranger qui au bout de ma langue portait leur vérité, qui rendait insoutenable ces secondes muettes pleines de vie, de justice, moi, l’étranger, j’avais la solution . J’allais parler. Leur corps, une fois ma parole échappée, se ressouderait-il, je l’ignorais. Mais j’allais parler…
Alors soudain je me levai, chancelant, hagard, et sortis. Une fois chez moi, je pris ma valise, bouclée à l’avance, et quittais le pays. Monsieur Jügg pourrait continuer à vivre sa petite vie recluse, personne ne le dérangerait, pas même d’un geste obscène ou d’un sourire en coin.
Car le malheur et l’âme du village, c’est moi qui les avais emportés.
Nous gravissons encore de multiples ruelles à sens unique et accédons enfin au promontoire où la gare routière sommeille et s’enrhume dans d’immenses flaques d’eau. Jadis conçue pour les charrettes et les carrioles, cet endroit a conservé son passé en ne quittant pas son aire géographique. C’est l’instinct des petites bourgades qui conservent leur mémoire en ne déplaçant rien de leur ancienne prospérité. John asperge involontairement quelques chalands benoîts en bordure des quais, avant de stopper le véhicule une dizaine de mètres plus loin, en face du bureau des messageries. Un gros bonhomme, qui doit faire office de lanterne signalétique vu sa rougeur extrême, se plante devant la portière avant du bus. Les vêtements qui collent à son corps comme une doublure de film comique désigne formellement l’une des victimes de John.
AK
Jour d’asphalte (23)

il avait bien tenté d’extraire quelques paroles de l’être impavide qui lui faisait face, mimant une incapacité à décrypter certains mots, mais monsieur Jügg, d’une main autoritaire, reprenait alors son papier et quittait promptement la boutique. Il n’y revenait que la semaine suivante, présentant la même liste, récrite avec la même fermeté. Une fois acquises toutes les marchandises, il reprenait son papier, réglait la note et repartait sans bonjour ni bonsoir vers son domicile, une petite maison en bordure d’un chemin de halage, sise à la sortie du village.
Monsieur Jügg, racontait-on, s’était installé depuis une quinzaine d’années dans cette chaumière près du canal. Personne ne l’avait vu pénétrer dans ces locaux et seuls les volets ouverts indiquèrent un matin qu’une nouvelle âme avait élu domicile au village. La tenancière du café « Aux Bons Amis », le seul bistroquet local, lançait à qui voulait l’entendre que notre homme était venu de la forêt contigüe à la maison qu’il occupait et qu’en fait c’était le diable en personne, ou du moins un satyre égaré. Elle entretenait la légende tout en essuyant ses verres, ajoutant chaque jour un élément nouveau qui rendait plus complexe, et donc plus mythique, la véritable origine de monsieur Jügg. Aux dires de la patronne, quand il m’arrivait d’aller « Aux Bons Amis » le vendredi soir, l’homme qui masquait le démon portait dans les traits de son visage de minuscules cicatrices qui de jour en jour se répandaient sur son front. Cela constituait pour la patronne un signe certain de la présence du Mal.
Ne l’avait-elle pas vu, alors qu’elle baissait le rideau métallique de son établissement, déambuler sur le chemin de halage, puis bifurquer soudain dans les broussailles noires que la forêt entretient ? Elle avait, ce soir-là, avec plus de promptitude encore, vivement poussé tous les verrous de ses portes. Pas de loup garou chez moi, maugréait-elle chaque fois qu’elle achevait son histoire. Je dois avouer que je donnais peu de crédit à de tels racontars. Je replaçais la bistrotière dans son contexte : le débit de boissons. La majeure partie du village néanmoins abordait le sujet en y mêlant sorcellerie et autres superstitions, toujours à la défaveur de monsieur Jügg, ce qui ne faisait que confirmer mes propres pensées : si votre vie ne traverse pas celle des autres, si nulle nécessité de fréquentation d’autrui vous oblige, alors tous ces gens, frustrés de par votre énigmatique capacité à vivre seul se rebiffent et vous maudissent, amalgamant leur propre incapacité au triste sort qui est le leur et dont immanquablement vous devenez la cause.
Une chose cependant m’intriguait depuis deux ans : le mutisme de monsieur Jügg et cette façon d’agir comme s’il voulait ne pas laisser de trace. Je m’étais lié d’amitié avec le nouvel instituteur, Jean Jacques M., qui enseignait depuis maintenant trois ans à l’école communale, fermée pendant des années. (Suite au départ de Maggie Mac Gee, mutée, à Glasgow où elle épousa le jeune Peter Mac Pherson, devenu un homme après la mort de son père, écopeur certifié d’estomacs de vieux pêcheurs remplis de bière. Le jeune Peter racheta le pub et y vit encore, en compagnie de Maggie et de ses trois enfants.) Jean Jacques n’avait la charge que de dix enfants auxquels il tentait, vainement disait-il, d’inculquer les plus élémentaires notions d’écriture et de mathématiques. Nous avions peu évoqué jusqu’à lors la personnalité de monsieur Jügg, préférant discuter de littérature, de politique, bref de choses plus passionnantes par le fait même qu’elles nous arrachaient du carcan de la bourgade où rien ne se passait de particulièrement important.
Nos sujets commençant à se tarir, la nouveauté de l’un se heurtant peu ou prou aux concepts de l’autre, nous dérivâmes lentement vers la vie que nous menions ici, et sur les personnages qui la hantaient. Nous en vînmes donc à nous intéresser plus particulièrement à mosieur Jügg, le seul qui fut à nos yeux digne qu’on y réfléchissât. Jean Jacques m’apprit ainsi que les enfants le surnommaient le père Méphisto et qu’ils lui avaient raconté de bien curieuses choses sur son compte que lui, homme sensé, avait considéré comme pures affabulations de gamins, ou répétition de logorrhées parentales. Seul un fait l’avait intrigué, dans les histoires des gosses. Un fait qui n’avait rien d’étrange mais qui, replacé dans le contexte, le rendait bizarre. Trois gamins qui jouaient à faire ricocher des pierres plates sur le canal avaient surpris le père Méphisto lessivant ses vieilles fripes dans un baquet de bois attenant à la maison. Et dirent-ils, il portait dans le dos un immense tatouage coloré que les mouflets, débusqués par l’homme, n’avaient eu le temps de bien décrire. L’un disait « oui, monsieur, ça ressemblait à ma mère », l’autre « on aurait dit un grand diable avec du feu et une fourche » ; quant au troisième, Jean Jacques m’avoua qu’il lui sembla vider son sac d’imaginaire et n’en retînt rien. Un tatouage, cela n’avait rien d’étrange, mais il fallait que nécessairement l’homme vint de loin car dans toute la région et dans les départements voisins il ne se trouvait pas un tatoueur digne de ce nom. Jean Jacques crut bon de rajouter qu’à son avis monsieur Jügg avait duû fréquenter les bagnes. Je lui répondis que les bagnes n’existaient plus depuis belle lurette. « Dans notre pays oui, mais à l’étranger ?… » me rétorqua-t-il, un brin soupçonneux. Je n’insistais pas. Je connaissais suffisamment le côté xénophobe de mon interlocuteur pour clore notre discussion. Nous nous quittâmes ce soir-là très tendus.
Je me rendais alors progressivement compte que tous, Jean Jacques compris, craignaient l’intrus et que je devenais malgré moi le jouet de leurs manigances. L’instituteur avait été très rapidement intégré dans la population, de par sa fonction son utilité et sa décontraction apparente et avait très vite compris la notoriété qu’il tirerait de la démarche dont les habitants l’avaient habilement chargée auprès de moi. Car je réalisais depuis peu que malgré mes nombreuses années de présence dans le bourg je restais un étranger avec qui on aimait bien discuter, certes, et trinquer, mais qui n’avait qu’une vague réputation de petit rentier curieux. Du moins ma perception des choses me parut-elle ainsi, n’ayant jamais fait part à quiconque de la source de mes revenus ni de mes états d’âme. Impressionnés qu’ils étaient tous par monsieur Jügg, et nul n’osant démarcher en faveur de son départ de la commune, ils avaient chargé Jean Jacques de me convaincre d’aller rendre visite à l’anachorète pour en savoir plus sur son intimité, afin qu’ils puissent pénétrer plus aisément dans sa vie privée et utiliser cette connaissance à le dénigrer à leur aise. Il leur serait alors plus simple de ricaner dans son dos, d’agir par un harcèlement continu jusqu’à l’insupportable, une haine tenace. Je comprenais que ne sachant rien de monsieur Jügg ils n’avaient aucune prise sur lui, et que l’homme qu’ils désignaient du doigt comme personnification du Mal incrustait sans le savoir dans la médiocrité de ces gens un mal bien plus réel, bien plus vivace encore, la dépendance.
Je continuais néanmoins mes incursions au bar « aux bons amis », et me réconciliais avec Jean Jacques. Les jeux étaient clairs. Deux ou trois personnes se lièrent à nos conversations, dont le centre d’intérêt restait monsieur Jügg. Le cercle se refermait sur moi, mais bien qu’écœuré par leur mesquinerie, je me prêtait au rôle qui m’incombait. Oui, la présence de cet homme devenait intolérable. Les enfants en avaient peur. Certes il n’ennuyait personne, retiré dans dans sa maison et muet comme une carpe. Mais il empoisonnait tout le voisinage. Avait-il une langue, des cordes vocales en bon état de marche, messieurs, je ne crains ni Dieu ni Diable, et j’irai s’il le faut visiter l’intrus.
Il y eut ce soir-là un grand remue-ménage au bar des « Bons Amis ». Chacun y allait de sa tournée, de ses encouragements, non pas à grands cris, mais par une phrase glissée à mon oreille, une tape amicale sur l’épaule, un clin d’œil appuyé, un sourire complice. La perfidie à cœur ouvert, visible, à fleur de peau, l’épicier, Jean Jacques,, la tenancière et tous les autres présents, tous suaient la médiocrité. Spectacle insupportable que j’aurais fui à l’instant si je n’avais pas été décidé à mener jusqu’au bout mon scénario. Je stipulais à mes congénères que la date de la visite n’était point fixée et que, pour qu’elle ne parut pas intéressée, j’irai chez monsieur Jügg un jour de semaine, lorsque chacun est occupé à sa besogne. Je connaissais déjà le motif fallacieux qui me permettrait d’aller frapper chez l’homme, mais nul ne devait le savoir. Tous approuvèrent. Nous trinquâmes une dernière fois, puis je regagnais mes pénates.
AK

Jour d’asphalte (22)

John chantonne à voix basse, tapotant le volant au rythme lancinant de ses souvenirs d’enfant. Quinze heure vingt. Nous allons arriver à Barcanche sous les néons orageux, les acclamations diluviennes. Toute une fanfare divine accorde son allegro furioso dont John restitue les gammes en murmurant. Barcanche, aux remparts à la Vauban, grise sous la bourrasque, bleue sous l’azur, blanche sous son blason de ducale oppression, rouge durant la saison de chasse à l’ours, Barcanche la cité provinciale au cœur du massif montagneux nous voici, conquistadors modernes, montant à l’assaut de tes tours, déjouant l’huile bouillante que vomissent les mâchicoulis sur le moteur de notre invincible machine , nous voici, sous l’étendard joyeux de Beau Gosse, roi d’Abribus, venus semer désordre et barbarie sur ton sol hautain !
« – Rudolf ! Dit John rêveusement, peux-tu me lire le texte de la page soixante de mon bouquin d’histoires courtes, celui qui est écorné et graisseux, il me trotte dans la tête mais je ne m’en souviens plus. »
Je fouille dans le sac et saisis l’opuscule. Les pages sont lourdes et les tourner fatigue.
– » Voilà voilà, ouvre grandes tes esgourdes. Je cite :
« Je vis la tête de mon homme
Dans un panier, à l’ombre
J’y posai un baiser
Qu’un voleur de panier emporta. »
(Histoire d’amour)
« -Merci vieux !
« – C’est naturel, Beau Gosse ! A ton âge les anges soufflent encore dans les trompettes de la Renommée, bien que celles de Jéricho se soient mutées en trompes de Fallope.
« – On a l’amour qu’on veut, pas vrai ?
« -Deo gratias ! »
Nous glissons sous la porte saint Martin et accédons au cœur de la ville. Les bâtisses en espalier, les rues étroites où les passants se raréfient, la tonalité grise reflétant l’état du ciel -d’ardoise-. Tristesse magique des rues hivernales expédiées à la montagne pour un rude exil afin que plus de vigueur naisse de ses habitants casaniers durant la saison estivale. Illusion touristique sous le soleil de mai quand la vie se compromet à l’ombre frémissante des mélèzes. Douze mois par an suintent ici de ragots près des cheminées. L’étranger ignore que dans l’âtre où se consument chênes et châtaigners les clans, à la veillée, échines glacées et fronts brûlants, causent. Les bûches enclines au ressuage, les fagots embrasant de leurs lueurs exquises ces cadavres sournois, embellissent ce décor rustique. Et nul dans cet habitacle mécanique ne saurait me contredire, je connais trop ce genre de lieux pour ne pas les maudire. Car de bonnes raisons stimulent ma rancœur.
Quand je suis arrivé pour la première fois dans cette bourgade, il y a une dizaine d’années, mes premiers contacts avec les habitants s’établirent par la question : « connaissez-vous monsieur Jügg? ». La réponse était simple : « non, qui est-ce ? ». Alors, adoptant un ton confidentiel, ils me glissaient inlassablement à l’oreille : « vous aurez bien le temps de le connaître, mon bon monsieur, bien le temps… »
Cela était bien vrai. Combien de fois en effet ai-je vu depuis passer dans la rue principale la silhouette décharnée de monsieur Jügg, vêtu d’une antique redingote et d’un haut-de-forme d’une autre époque qui allongeait en démesure la verticalité déjà excessive de son corps, je ne saurais le dire. Personne ne saurait le dire. L’épicier chez qui se rendait régulièrement monsieur Jügg (c’était sa seule démarche en ville) laissait courir toute une foule d’idées sur son compte, racontant qu’il se contentait de tendre au commerçant une liste sur laquelle tous les produits nécessaires étaient inscrits. L’écriture, rajoutait-il encore, ressemblait en tous points à l’homme, longiligne, aigüe et cassante comme l’était son visage ; il avait bien tenté d’extraire quelques paroles de l’être impavide qui lui faisait face, mimant une incapacité à décrypter certains mots, mais monsieur Jügg, d’une main autoritaire, reprenait alors son papier et quittait promptement la boutique. Il n’y revenait que la semaine suivante, présentant la même liste, récrite avec la même fermeté. Une fois acquises toutes les marchandises, il reprenait son papier, réglait la note et repartait sans bonjour ni bonsoir vers son domicile, une petite maison en bordure d’un chemin de halage, sise à la sortie du village.
Monsieur Jügg, racontait-on, s’était installé depuis une quinzaine d’années dans cette chaumière près du canal. Personne ne l’avait vu pénétrer dans ces locaux et seuls les volets ouverts indiquèrent un matin qu’une nouvelle âme avait élu domicile au village. La tenancière du café « Aux Bons Amis », le seul bistroquet local, lançait à qui voulait l’entendre que notre homme était venu de la forêt contigüe à la maison qu’il occupait et qu’en fait c’était le diable en personne, ou du moins un satyre égaré. Elle entretenait la légende tout en essuyant ses verres, ajoutant chaque jour un élément nouveau qui rendait plus complexe, et donc plus mythique, la véritable origine de monsieur Jügg. Aux dires de la patronne, quand il m’arrivait d’aller « Aux Bons Amis » le vendredi soir, l’homme qui masquait le démon portait dans les traits de son visage de minuscules cicatrices qui de jour en jour se répandaient sur son front. Cela constituait pour la patronne un signe certain de la présence du Mal.
AK
Un conte pour enfants pas sages : Rabdalou, le petit loup.

Rabdalou le petit loup.
Rabdalou était pépouz dans la grotte où logeait toute la famille. Dans ce pays lointain qui se nommait le Balkanyland, la meute s’était réfugiée dans les monts escarpés et observait le monde des humains en riant. Quand l’hiver roidissait leur pelage, ils avaient pour habitude, une habitude prise aux hommes, de jouer aux cartes et selon leur humeur, ces cartes étaient soit géographiques, soit ludiques. Ainsi les voyait-on s’affairer autour du jeu des sept familles, quand la neige tombait drue sur les rochers glacés comme l’or qui soudain enrobe des bouchées chocolatées féériques dans la perspective des nouveaux nés qu’à Noël eux-mêmes tenteraient de croquer. La famille était si nombreuse, la grotte si vaste, que chacun au jeu trichait à volonté. Je voudrais le père (mais lequel?), la mère, le fils et le grand-père. La grand-mère (laquelle ?) avait déjà été consommée et la pioche ne validait plus le beurre ni la galette des rois, ni le petit chaperon rouge. Carême, le chef incontesté, prenant ses cartes en main, décrétait le début et la fin de la partie, avant de se réfugier sur la margelle en granite pour y travailler sa stratégie d’envahir puis de dévorer rois, princes, bourgeois obèses et princesses botoxées, dictateurs auto-proclamés sauveurs de la nation, bref tous ces ennemis de la nature animale que l’on pourchassait depuis des siècles.
Rabdalou avait sept mois et ses mâchoires étaient déjà garnies d’un scintillant chapelet de dents capables de croquer un chasseur ou une poupée russe, en fait tout ce qui se présenterait si Carême l’autorisait à descendre dans la vallée, puis à courir vers la ville brillante comme des feus fêtent dans les cimetières saint Elme et ses pets d’artifices. Mais pour l’heure Rabdalou ne possédait que ses rêves pour espace vital, d’autant que la neige traçait les empreintes de ses petites pattes griffues et la meute maintenait un ordre familial où l’évasion était interdite. Comme la grotte ne possédait ni télévision, ni 5G ni réseau social (les faces de boucs étaient stockées dans un repli minéral non accessible aux louveteaux), les petits jouaient aux osselets et écoutaient des chansons douces que leur chantaient des aïeuls qui avaient connu un certain Reggiani, un soir de frimas, jadis. Ils revisitaient aussi de vieilles lectures dans lesquelles on les avait ridiculisé, et Ysengrin dans le clan était perçu comme une insulte. Ce bandit de La Fontaine qui préférait les renards, quel ignoble fabuliste, murmurait-on à table, quand seule la soupe constituait le repas, que dans le ciel les oies de Guinée migraient en Afrique, et que les flamants roses filaient en Camargue boulotter des crevettes pour retrouver leur joli teint printanier. Rabdalou salivait abondamment en les regardant passer au dessus de l’abrupte montagne. Parfois une perdrix des neiges se suicidait dans son museau, ou un lièvre bigleux qui cherchait ses lunettes sans branches que l’on nomme bésicles.
Bizarrement, car elle avait œuvré contre la dynastie des lupus, on vouait dans ces contreforts de montagne avec vue sur la planète celle que l’on nommait « la louve ». Elle avait sauvé deux braillards humains abandonnés dans une cuvette en plastique qui flottait sur le Tibre. Le geste était héroïque, mais les conséquences siècle après siècle, malheureuses pour les loups. Sommés de fuir dans les Apennins, puis les Carpathes, puis chez les mères-grands des campagnes d’Ukraine, jusque dans les caves viticoles du Pic Saint Loup , dans le sud de la France. La louve fut adoubée tant par les hommes que par les loups car dans l’ivresse si l’homme est un loup pour l’homme le loup est un homme pour le loup, raison pour laquelle tout le monde se chamaille depuis deux millénaires.
Rabdalou n’avait cure de tout ceci. Il grandit deux hivers durant et put enfin se sentir apte à mener sa propre vie, ce que chez les humains on nomme en parlant d’un rôdeur ou d’un assassin un loup solitaire. On le vit ainsi parcourir les banlieues des grandes et des petites villes, on le rencontra même dans le désert où un aviateur dessinait sur son calepin un mouton pour un petit berbère blond qui voulait fêter l’Aïd. L’aviateur chassa notre pauvre Rabdalou car il sentait le fennec. Le fennec est ce petit animal à grandes oreilles qui ressemble beaucoup à un lapin mais sans bésicles. Déçu ne n’avoir pu croquer le croquiseur et le mouton et l’enfant, Rabdalou regagna sa contrée du pays de Balkanyland où il ne vit personne. Une rafle avait eu lieu, menée par les chasseurs qui raffolaient de tirer en rafales sur les loups dépourvus de passeports et de passe-droits pour se refaire une santé hors des prisons.
Dans le repli minéral il trouva les faces de boucs bien empilés et en saisit une. Les chasseurs avaient oublié un de leurs émetteurs et du coup Rabdalou put se connecter à la misère du monde et des siens. Il était devenu adulte, avait parcouru des milliers de kilomètres et se retrouvait à son point de départ, sans autre ambition que de vivre librement dans ce pays qui l’avait vu naître. Pourtant il se sentait ridicule, semblable à l’Ysengrin des fables de ce sacripan de La Fontaine, avec ses morales tirées au cordeau. Sur une des cartes géographiques qui jonchaient le sol, piétinées par les chasseurs , il reconstitua le parcours de sa courte vie. C’était une ligne étrange qu’avec un bout de bois calciné entre ses dents il rapporta sur la poussière lisse et froide comme le cahier de notes d’un mauvais élève. Plus il remuait son crayon improvisé, plus une phrase semblait se révéler sur le sol : je t’attends. Face à ce mystérieux message Rabdalou ne sut que penser. Par quelle magie avait-il compris ce langage, cette phrase, lui qui ne connaissait que l’art de survivre et de croquer la vie toute crue et sans formalité ?
Peut-être que quelque part le loup qu’il était était devenu homme. Je t’attends.
Lui qui rêvait enfant de parcourir le monde se trouvait à présent devant la véritable réalité de ce monde : qui l’attendait ? Était-ce la Louve romaine, Carême, la santé défaillante des geôles de Balkanyland, ou ce petit berbère aux cheveux blonds ? Ou n’était-ce pas lui, qui attendait inutilement que les choses viennent sans bouger les petits doigts de sa patte griffue non rétractile ?
Soudain il se souvint de cette phrase entendue dans une grande ville où il avait erré des heures.
Allez, mon p’tit loup, tu montes ?
21 11 2021
AK







Commentaires récents