le petit karouge illustré
les babillages de Chinette, les coloriages de Chinou
Une belle histoire d’amour que celle de Lucien B.

La nouvelle vie amoureuse de Lucien B, débuta exactement un vendredi, sous l’abribus de la ligne 13, qui conduit habituellement les gens de la proche banlieue vers le centre ville. Il était seul à l’arrêt, ce qui était logique car l’arrière du bus se dessinait encore dans la perspective de la rue, bus qu’il venait auparavant de rater car les deux piles AAA (de la marque Moody’s) de son réveil avaient flanché la nuit précédente, pendant qu’il ronflait. Rien de bien grave. Récemment licencié, il n’allait en ville que pour se balader et, le cas échéant, acheter un autre jeu de piles pour plus tard, au cas où il trouverait une embauche dans les dix ans à venir.
Lucien venait d’avoir la cinquantaine, et ressemblait physiquement à l’un de ces personnages sortis de l’univers de Dostoïevski ou plutôt, dans ce contexte, de Gogol, tant son allure sur le boulevard rappelait assez bien Piskarov, l’un des deux héros de la Perspective Nevski. De taille moyenne, à peine bedonnant, les épaules légèrement voûtées, il n’avait rien qui puisse attirer les femmes, et son petit bouc taillé en pointe aggravait son faciès de telle sorte qu’il eût pu passer pour un diable surgissant d’une boîte en carton dans un cirque ambulant. Cependant, sous le manteau (nous étions fin novembre, et le froid sévissait entre deux rafales de vent) qui le vêtait de pied en cap, se devinait une silhouette à l’aspect sympathique, une certaine élégance qui, dès qu’on le dépassait, perdait toute magie.C’était un homme à fréquenter en lui tournant le dos. Ce que les femmes avaient compris depuis longtemps, car leurs six sens n’en généraient au final qu’un : le sens interdit, dans lequel elles l’éconduisaient sans autre procès verbal.
Si l’on peut dire de certains morts qu’ils ont simplement oublié de vivre, la formule inverse était tout aussi applicable concernant Lucien : la vie oubliait de le faire mourir, mourir de plaisir dans les bras d’une femme, s’entend. Mais existait-il encore des femmes capables elles-mêmes de mourir dans les bras d’un homme tel que lui ? Hélas, oui. Et le souvenir de ces étreintes cheminait dans sa tête, ce vendredi-là, mettant de la gaieté dans ses pas et du baume sur ses plaies.Dans sa cervelle bourdonnait les bribes d’un poème de Paul Eluard :
« Il la prend dans ses bras
Lueurs brillantes un instant entrevues
Aux omoplates aux épaules aux seins
Puis cachées par un nuage.
Elle porte la main à son cœur
Elle pâlit elle frissonne
Qui donc a crié ?
Mais l’autre s’il est encore vivant
On le retrouvera
Dans une ville inconnue. »
(« La vie immédiate », poésie Gallimard)
C’est ainsi qu’il atteignit le centre ville désert. Le temps gris et le crachin continu n’invitaient pas les citadins à mettre le nez dehors, ni à sortir les mains des poches. Les portes automatiques du mini market s’ouvrirent quand il passa devant et l’aspirèrent vers l’intérieur, porté par le souffle d’air tiède issu de la chaufferie bruyante qu’une musique sans notes couvrait à peine. Chaloupant dans les allées aux gondoles colorées, il croisa quelques chariots poussés par des ménagères en quête de bien-être à prix discount, de ces femmes dont le monde était envahi depuis la disparition de la féminité et du savoir-vivre, au profit d’un consumérisme à tout-va qui les rendaient obèses dès leur plus jeune âge. Lucien ne pouvait nier que malgré ses critiques acerbes ces corps enrobés à l’extrême lui procuraient une certaine excitation, un tantinet maladive, voire obsessionnelle par le caractère dramatique de sa situation personnelle. Beaucoup d’entre elles étaient accompagnées d’enfants piaillards et de maris jaloux, ce qui tempérait les penchants de Lucien, qui trouva le rayon des piles AAA, en saisit un paquet et fila aux caisses.
Là, par contre, c’était un tout autre univers. Les trois caissières étaient magnifiques, chacune dans son genre. De la jeunette récemment embauchée, aux gestes maladroits et aux mains parées de faux ongles peints, la blouse rayée avec le logo de l ‘épicier dans le dos et le prénom épinglé au revers de la poitrine, en passant par la patronne venue s’installer en renfort à la caisse centrale, femme mûre mais non dénuée d’un charme méditerranéen, yeux en amande aux paupières discrètement bleutées, cils noircis de rimmel malgré la blondeur des cheveux, la lippe au sourire commercial figé dans le décompte des produits en partance et enfin, la plus jolie des trois, celle qui faisait fantasmer les célibataires endurcis : Léa.
Léa était sans conteste l’idéal féminin que Lucien imaginait dans ses rêves les plus féconds. Depuis des mois il passait à la caisse où celle-ci œuvrait, avait noté ses horaires sur un calepin, remarqué l’absence d’alliance à l’annulaire, et comme tout client qui se respecte, il lui plaçait toujours un mot gentil à chaque passage. Ainsi avait-il créé un lien, qu’il s’évertuait à étoffer au fil des mois.Et ce fut bel et bien ce vendredi là que débuta la nouvelle vie amoureuse de Lucien B. Elle quittait son service quand il présenta son paquet de piles, quand elle lui dit : « c’est bien parce que c’est vous. Pouvez-vous pousser la barre derrière vous, je ferme, merci. »L’instant idoine pour agir, l’occasion ne se représenterait pas de sitôt, songea-t-il. »Vous êtes gentille, puis-je vous offrir un café, je vois que vous avez terminé votre service ». Elle accepta. Incroyable ! Comment un aussi joli bout de femme pouvait donc accepter l’invitation d’un vieux clou comme lui restait une énigme. Comme quoi la vie n’est pas qu’un champ de mines, parfois.
Un quart d’heure plus tard ils étaient attablés dans un café de la ville. Une semaine plus tard ils dormaient dans le même lit. Deux mois s’écoulèrent avant que Léa ne vienne habiter chez Lucien, dans un T3 qu’il loua dès que leur relation prit une tournure sérieuse. Il dégota quelques missions en intérim et Léa dégarnit en douceur plusieurs gondoles pour assurer leur quotidien. Tout allait bien. Ils s’entendaient comme deux larrons en foire. Le réveil sonnait avec régularité tous les matins de la semaine, le lit grinçait avec de petits cris d’oiseau, et l’hiver avait sauté l’an pour mieux étaler ses promesses de bonheur conjugal. Ainsi, au début du mois de mars se pérennisait une idylle printanière, saupoudrée de petits projets communs.
Léa aimait les animaux et avait rêvé depuis son enfance d’avoir un chien.Maintenant que le couple était bien ancré dans sa relation, et qu’ils étaient trop vieux pour avoir un enfant (Léa n’en voulait pas), l’idée du chien pouvait raisonnablement s’envisager, malgré les réticences de Lucien. Mais que ne ferait-il pas pour elle, lui qui ressemblait à un personnage de Gogol, ils iraient promener le toutou sur leur Perspective Nevski, main dans la main, tenant en laisse l’animal, un bon gros chien qui ferait s’écarter les passants à leur passage. N’était-ce pas la voie royale d’un couple uni et fier d’être ensemble ?
A Pâques, le chiot fit son entrée dans le logement. De nouvelles habitudes furent prises, comme celle de sortir promener l’animal trois fois par jour, par tout temps. Une part du budget servit à l’entretien de Gogol, nom qui fut donné d’office au canidé lors de son achat. Quelques contraintes apparurent néanmoins au fil du temps. Non seulement Gogol grandissait, mais encore le lit grinçait de moins en moins souvent,car l’animal avait l’ouïe fine et les petits cris d’oiseau échappés du matelas le faisaient aboyer. Lucien nota également que les promenades obligatoires de Gogol, lorsqu’elles étaient effectuées par Léa, duraient de plus en plus longtemps, comparées aux siennes. Il est vrai qu’il était fréquent de croiser sur le boulevard bien d’autres propriétaires de toutous, hommes femmes enfants, et que souvent la conversation s’engageait pendant que les chiens batifolaient.
Jusqu’au jour où Gogol rentra tout seul, tenant sa laisse dans sa gueule. C’était un vendredi. Lucien ne se souvenait plus de l’heure, le chien avait mangé le réveil et cela n’avait plus désormais d’importance. Ce qu’il garda en mémoire, c’est que ce jour-là sa nouvelle vie amoureuse s’acheva tout net. Et qu’il devrait dormir avec le chien, devenu gros comme une vache.
06 11 2011
AK
(retranscrit jusqu’à l’épuisement de mes petites menottes le 15 06 2021)
Juste un mot

Tiens, un mot !
Posé là, sur la table, sans permission, comme un coude, un mot têtu et muet, pas un de ces mots qui en appellent d’autres à la rescousse, un mot solitaire, hiératique, dur comme fer et dont l’odeur pourtant rappelle la terre. Un mot crayeux dont on sent -en le voyant, tout simplement- le parcours aventureux : des marigots du Mississipi aux glaciers d’Islande, des toundras sibériennes aux déserts sahariens, tout gorgé d’iode, rouge et ridé par l’océan Indien, débonnaire à Macao, calligraphe à Pékin, maori de Sydney, new-yorkais de Frisco. Un mot qu’on reconnaît mais ne se salue point, haut comme une girafe, fort comme un ouragan, mais immobile et frissonnant dès que la main l’approche. Un mot qui craint que le stylo le pique, le blesse, le tue.
Je m’en suis approché, patiemment, dans un silence total. Il respire. Son souffle court pénètre mes narines froides. Il m’observe. Son petit ventre couine. Depuis combien de jours, de mois, d’années n’a-t-il mangé, frétillé, souri ? Il murmure, le bois de la table et la belle nappe le mettent en confiance. Il ne murmure pas, il ronfle ! Sans permission, comme un coude. Quelle sieste épatante ! Il vibre maintenant comme un moteur d’avion, le plafonnier en cristal cliquette, c’est vraiment étonnant, ravissant, de le voir si détendu, si bénèze, si splendide. Il s’épanouit et de petites lumières s’évaporent de sa peau, fuligineuses d’abord, puis claires et dorées, éclaboussant l’espace de couleurs enchanteresses.
Puis soudain, les couleurs à leur tour émettent des sons qui se transforment en paroles et s’inscrivent en nouveaux mots aux murs, aux planchers, aux plafonds. La table en est maculée, comme une joyeuse bamboche, et tout cet ensemble rit, chante, exhale le bonheur. Ma tête s’en remplit à son tour et me voici dansant dans l’air saturé de senteurs exquises. Baissant alors les yeux, je distingue son contour. Il me voit, se tait, sait :
c’est l’Amour.
09 10 2005
AK
(recopié le 12 06 2021)
silence

Voici les chaises vides
Les platanes ombrageux
Et ce filet d’eau qui cascade
Au milieu du bassin de pierre
Au milieu de la place déserte
Où les oiseaux se taisent
Et mon stylo qui bave
Sous le soleil en deuil
Comme l’âne s’abreuve, seul,
Naseaux sur la margelle
De cette eau claire
Comme un bonheur d’été.
10 06 2021
AK
Les mardis de la poésie :les frères Jacques (sur scène de 1946 à 1982)

(paroles Rudi Revil et Michel Vaucaire, mais sans certitude)
réf : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38078456k
A LA SAINT MEDARD
À la Saint-Médard mon Dieu qu’il a plu
Au coin du boulevard et de la petite rue
À la Saint-Médard mon Dieu qu’il a plu
Y aurait pas eu d’bar on était fichus
À la Saint-Médard mon Dieu qu’on s’est plu
Tous deux au comptoir en buvant un jus
À l’abri dans l’bar on s’est tellement plu
Qu’on est sorti tard quand il a plus plu
Quand il pleut le jour de la Saint-Médard
Pendant 40 jours faut prendre son riflard
Les marchands d’pépins et de waterproofs
Se frottent les mains, faut bien qu’ces gens bouffent
Dans notre petit bar on se retrouvait
À midi un quart et on attendait
Quand il pleut dehors, dedans on est bien
Car pour le confort, la pluie ne vaut rien
Pour tout arranger il a encore plu
La Saint-Barnabé oh ça tant et plus
Pour bien nous sécher au bar on a bu
Trois jus arrosés puis on s’est replu
Saint-Truc, Saint-Machin, toujours il pleuvait
Dans le bar du coin, au sec on s’aimait
Au bout de 40 jours quand il a fait beau
Notre histoire d’amour est tombée dans l’eauL
On attend de pied ferme ce sacré Barnabé! Pour l’heure c’est grand beau temps !
Les Frères Jacques est un quatuor vocal français, actif de 1946 à 1982, composé d’André Bellec, Georges Bellec, François Soubeyran et Paul Tourenne. Le groupe a atteint un sommet dans l’art de combiner le chant et le mime, et a interprété des chansons de nombreux auteurs, notamment de Prévert et Kosma (Barbara, En sortant de l’école, parmi de nombreuses autres), de Serge Gainsbourg (Le Poinçonneur des Lilas), de Stéphane Golmann (La Marie-Joseph), ou de Ricet-Barrier (Eugénie de Beaulieu).
Les petits crobards du dimanche : radio Lucette et ses chouchoux




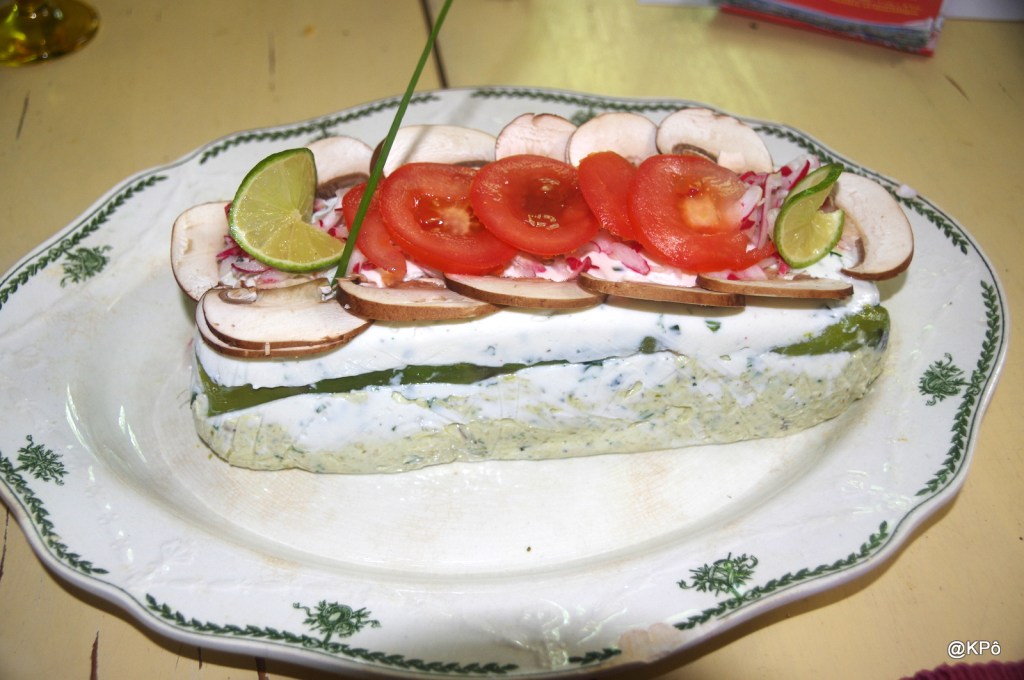




Chat assis à l’ombre du soir

Aujourd’hui j’ai envie de me pendre à la première branche venue.
Je mesure la longueur de ma corde de chanvre, scrute l’arbre
Qui me semble le plus approprié, tronc lisse, branches maîtresses,
Feuillage épanoui. Celui-ci me convient. J’envoie la corde.
Miséricorde ! Un chat est perché dessus et me regarde avec mépris.
Qui es-tu ? me demande-t-il, pour vouloir prendre ma place .
Je suis un souvenir d’enfant allant et venant sur une balançoire
Maintenant je suis l’hérésie de ma vieillesse, l’ombre du soir,
La dernière braise des crémaillères quand les feux s’éteignent
Et toi, animal des Enfers, qui depuis des siècles me surveille
Te moquant de savoir sur quel bout je m’assieds pour scier la branche.
Je ne me moque pas, seulement observe tes gestes incohérents
Pauvre homme qui apprit voici des siècles à marcher sur un fil
Puis construisit des ponts et enfin des fusées loin des canopées
Que pourrais-je te dire alors que ma présence seule devrait suffire ?

– »Sache alors, pauvre homme, que depuis ta naissance
La Mort te tient en laisse , que l’arbre ne se souviendra de toi
Comme n’étant qu’un fruit étrange sous son épais feuillage
Sur la branche duquel un chat noir, véritable témoin, décrira
Plus tard la danse des fantômes autour de croix en flammes. »
« -Le monde m’insupporte, le désespoir enroule ses nœuds
Comme des rivières confluent et s’associent de la source
A la mer, aux profondeurs marines des pêcheurs engloutis. »
« -Et toi tu voudrais que ton corps suspendu, arrogant et fier
Se balançât au vent sous l’air frais des potences, des vies
Dont jamais tu ne t’es rapprochées, élégance imbécile
Des vieillards inaptes à monter sur l’escabeau fatidique,
Tu me fais rire, pauvre homme ! Le suicide, le véritable,
C’est la peur de vivre de ceux qui en sont incapables,
C’est le bonheur fasciste de faire souffrir les illusions
D’embraser les crémaillères pour inaugurer un néant primitif. »

« – Je ne sais pas. J’étais un homme je suis devenu une corde
Nouée trois fois autour de ma ceinture. Mon pantalon tombait,
L’arbre ne nourrissait personne mais nous avions tous faim
Nous, les amis des bêtes, tels que toi le chat, nous les dévorâmes
Sans appétit, sans voracité, simplement par bêtise,
Mais tu connais l’histoire, et où se place l’Homme
Pour scier la branche. Comprends que je n’aie plus d’espoir
Et laisse-moi jeter vers le ciel cette corde encore souple,
Mais ne dis pas aux hommes la vérité, dis-leur en riant
Que j’ai tiré ta queue et me suis envolé dans l’air des temps heureux.
05 06 2021
AK
L’enveloppe (7)

L’enveloppe 7
Fin du chapitre précédent :
Voilà bien les questions sans réponse que je n’ai pas osé lui poser. Cette histoire m’était tellement étrange depuis le début ! Une lettre écrite sur l’enveloppe, sans courrier à l’intérieur, cette adresse carcérale, ce courrier administratif reçu, me demandant d’assumer une paternité à la fois absurde et pathétique. Et cette femme sans sourire, qui sortait de prison comme des amants qui rompent sortent du lit conjugal, en deux mots je n’avais qu’une envie, me retrouver chez moi le plus vite possible.
A la réception, on nous demanda de remplir une fiche. Simple formalité nous déclara l’employé. Nous recevons ici, à tarifs très attractifs, des gens qui sortent de prison, me dit-il dans un français plus littéraire que les putain con bâtard etc qui finissent dans des dictionnaires que personne ne lisent. C’est par un coup d’œil furtif, pour envelopper ma vision sur l’espace qu’offraient le confort et l’ameublement de cet hôtel que je vis Gianni, accoudé à la balustrade du premier étage. Il me salua d’un geste de la main, mais ne descendit pas. Sa présence devait être dans une démarche thérapeutique quant aux libérées et à leur suivi.
Rien de particulier. Pas de réaction agressive. Bon comportement. Nous vous tenons au courant, sachant que votre fille doit pointer durant un ou deux trimestres gratuitement au registre des libérées sous conditions (etc etc).
Putain ! Je pouvais enfin rentrer chez moi, avec des cargaisons de doutes, et aussi pesants soient-ils, je n’avais qu’un désir immédiat : retrouver ma paix d’avant cette histoire. Mais était-ce possible ? »
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
J’allumais une cigarette et bus un Americano au comptoir pendant que Leïla déposait sa valise dans une des chambres du rez-de-chaussée. Je n’avais aucune envie de traîner ici et nos adieux seraient brefs, de ça aussi, mentalement, je me portais garant. Avant de reprendre la route, j’allais aux toilettes, quand je sentis une main s’accrocher à mon bras. C’était Leïla : « Jean, je crois que j’ai laissé mon rouge à lèvres sur le tableau de bord. Peux-tu me donner la clef de la voiture pour le récupérer ? » Je m’exécutais et filai aux latrines. Elles étaient décorées de fresques représentant des scènes érotiques très latines dans leur composition, telles qu’on en trouve à Pompeï (en fait, c’était plus kitsch que Vésuvien). De retour au petit bar, Leïla m’attendait. Elle me remit la clef, me remercia pour tout ce que j’avais fait pour elle, puis elle m’embrassa sur les joues et me souhaita bon retour. Je fis de même, lui souhaitant à mon tour bon courage pour l’avenir qui l’attendait désormais comme femme libre. Puis, sans tarder, je gagnai la Modus et démarrai.
Il était dix sept heures trente. En roulant jusqu’à la nuit je calculais que je pourrais atteindre Viareggio en rejoignant l’autoroute, dite Via Aurélia, à Follonica. Conduire sur les autoroutes italiennes est assez dingue et surtout hyper stressant ; quant à prendre les routes nationales, c’est quelque part pire, tant on traverse tous les bleds et le flux des voitures et camions y est aussi intense que sur les autostrades. Sur les unes on est obligé de foncer pied au plancher comme un lièvre, sur les autres c’est avancer à la vitesse de la tortue. Durant tout ce trajet je n’eus quasiment aucune pensée pour Leïla, trop occupé à conduire, concentré sur la route et les risques qu’elle comportait. Je fumais cigarette sur cigarette, tétant une bouteille d’eau presque tiède qui me tenait compagnie depuis mon départ de la fin juin. C’était la première fois que le goût de l’eau me remplissait de plaisir. Après moult appels de phares, de coups de klaxons, je parvins à Viareggio, ce bout de la Riviera, station touristique réputée. Je trouvais rapidement un hôtel où je pus passer la nuit. J’étais trop crevé pour réfléchir à quoi que ce soit et m’endormis comme une souche jusqu’au lendemain. Pour une fois, je ne téléphonais pas à Manuella, qui avait Sidonie en résidence chez elle durant mon absence.
Ce matin du quatre juillet, je me levais très tôt, bus un cappucino et mangeais un croissant dans une salle vide qui serait envahie d’ici une heure ou deux par les premiers touristes allemands, russes, belges, français et serbo-croates (ou hollandais bronzés?). Il me restait un bon millier de kilomètres à parcourir, c’était jouable. Alors, rebelote. Je m’insérais dans le trafic routier et roulais comme la veille à toute berzingue pour rejoindre la paix de mon petit pays, avec ses rosiers en fleur dans le jardin, sa rue tranquille et son facteur grognon. Par chance, il ne tomba pas une goutte d’eau pendant le trajet jusqu’à Vintimille, où je fis le plein de gasoil et me restaurais rapidement sur une aire colonisée par des familles aux enfants braillards qui laissaient traîner leurs déchets sur les espaces verts et les tables de pique-nique. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Comme à l’accoutumée, avant de me remettre en piste, je pris mon paquet de cigarettes dans le vide poche latéral pour m’en griller une. C’était la dernière. Mais question tabac, j’avais mieux géré que l’eau minérale. J’avais une cartouche à demie entamée dans le vide poche sous le tableau de bord. En me tortillant un peu, je défis le clapet et ouvris la boîte, puis palpai à l’aveuglette l’intérieur.
Il y avait bien quelques paquets qui n’attendaient que de partir en fumée, mais également un truc dur qui n’avait rien à voir avec un briquet : c’était un Smith and Wesson sorti de je ne sais quel polar à la noix, et je me retrouvai illico en pleine zoubia, dans une sacrée merde avec un flingue sorti de je ne sais où, mais qui avait très certainement une sale histoire à raconter. Ce n’était que la moitié du cadeau. Il y avait aussi un bout de papier plié en quatre. Cette fois-ci, pas d’enveloppe, juste un message écrit à la hâte. Je reconnus la même écriture que celle censée appartenir à Leïla. C’était bref et concis :
« Tu risques d’avoir une mauvaise surprise en rentrant chez toi. Comme tu m’as aidée, je te rends la pareille. Sache simplement que je ne m’appelle pas Leïla. Rentre chez toi et sois prudent, garde cette arme avec toi, elle peut t’être utile. Je t’en dirai plus dans quelque temps, si je peux. Cora »
J’étais pétrifié. Je crois qu’à cet instant j’ai enfourné cinq cigarettes en même temps dans ma bouche. Avant tout, je devais regagner mon domicile de toute urgence, en prenant toutes les précautions nécessaires. Cette affaire ne semblait pas du tout être une plaisanterie.
04 06 2021
AK
FIN DE LA PREMIERE PARTIE (ah ah ah!)

JR s’installe aux abattoirs d’Anderlecht : ne coupez pas! (les têtes)

Rendre visible les invisibles(extrait de l’article)
Dans sa démarche, l’ASBL(note : acronyme de???) anderlechtoise s’est rendu compte que beaucoup de gens avec qui elle travaille au cœur de ce lieu ne sont pas forcément visibles. «Nous voulons rendre visible les invisibles, confirme Anne Wathee. Sur les murs, nous avons affiché des visages de membres de notre ASBL, mais aussi de personnes qui travaillent à l’abattage, c’est-à-dire très tôt le matin. Eux terminent leur journée de travail, quand moi je commence la mienne. Il y a aussi les gens des champignons de Bruxelles qui travaillent, eux, sous-terre. »
L’objectif derrière le projet est, ici, de visibilité les uns pour les autres, mais aussi de créer un sentiment d’appartenance à ce lieu atypique.
Article paru dans « l’avenir » ce jour, journal belge (avec vidéo)

Il y a pigeons et pigeons

Extrait : « Toujours moins d’hirondelles des fenêtres, de moineaux friquets ou d’alouettes des champs. Mais plus de pigeons ramiers, de geais des chênes ou de mésanges bleues. Le bilan de trente années de comptage des oiseaux en France, publié ce lundi par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l’Office français de la biodiversité (OFB), fait état d’une «hécatombe urbaine et agricole». Et d’une «fausse bonne nouvelle» : la progression démographique de quelques espèces «généralistes» capables de s’adapter à tous les milieux, comme le pigeon, au détriment des espèces «spécialistes». Ce qui révèle en fait «une uniformisation de la faune sauvage, signe d’une banalisation croissante des habitats et d’une perte de biodiversité».«
Article de La Dépêche du Midi :
Extrait ; «
C’est un nouveau type de vol par ruse qui est signalé dans notre région. Une dame de 82 ans de Villeneuve-de-la-Salanque dans les Pyrénées-Orientales a été victime d’un vol à la …fiente de pigeon le 27 mai dernier. Elle se rendait au restaurant avec son mari.
En chemin, elle sent quelque chose lui tomber sur le dos. Elle se retourne. Un couple qui marchait derrière lui indique alors que des fientes de pigeon lui sont tombées dans le dos. Apparemment bienveillant, le couple aider la vieille dame à nettoyer les fientes avec des lingettes.
Le couple arrive au restaurant et c’est alors que le mari se rend compte que son épouse n’avait plus son collier autour du cou. La vieille dame pense dans un premier temps l’avoir perdu mais elle comprend rapidement qu’on le lui a volé.
« J’avais le dos plein d’un truc vert. J’ai dû enlever mon pull tellement il y en avait », confie-t-elle à l’Indépendant. Les filles de l’octogénaire se renseignent sur internet et constatent rapidement que l’arnaque à la fiente de pigeon existe bel et bien. «


Les mardis de la poésie : Agénor Altaroche (1811-1884)

Poéme tiré du site : https://www.dico-poesie.com/
Biographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%A9nor_Altaroche
La fête à l’Hôtel de Ville
19 juin 1837
Accourez vite à nos splendides fêtes !
Ici banquets, là concert, ailleurs bal.
Les diamants rayonnent sur les têtes,
Le vin rougit les coupes de cristal.
Ce luxe altier qui partout se déroule,
Le peuple va le payer en gros sous.
Municipaux, au loin chassez la foule.
Amusons-nous!
Quel beau festin ! mets précieux et rares,
Dont à prix d’or on eut chaque morceau,
Vins marchandés aux crus les plus avares
Et que le temps a scellés de son sceau…
Quel est ce bruit ?… – Rien, c’est un prolétaire
Qui meurt de faim à quelques pas de vous.
– Un homme mort ?… C’est fâcheux ! Qu’on l’enterre.
Enivrons-nous!
Voici des fruits qu’à l’automne
Vole à grand frais l’été pour ces repas:
Là, c’est l’Aï dont la mousse écumeuse
Suit le bouchon qui saute avec fracas…
Qu’est-ce ?… un pétard que la rage éternelle
Des factieux ? – Non, non, rassurez-vous!
Un commerçant se brûle la cervelle…
Enivrons-nous!
Duprez commence… Ô suaves merveilles !
Gais conviés, désertez vos couverts.
C’est maintenant le bouquet des oreilles ;
On va chanter pour mille écus de vers.
Quel air plaintif vient jusqu’en cette enceinte ?…
Garde, alerte ! En prison traînez tous
Ce mendiant qui chante une complainte…
Enivrons-nous!
Femmes, au bal ! La danse vous appelle ;
Des violons entendez les accords.
Mais une voix d’en haut nous interpelle .
Tremblez ! tremblez ! vous dansez sur les morts
Ce sol maudit que votre valse frôle,
Le fossoyeur le foulait avant nous…
Tant mieux ! la terre est sous nos pieds plus molle.
Trémoussez-vous!
Chassons bien loin cette lugubre image
Qui du plaisir vient arrêter l’essor.
Déjà pâlit sous un autre nuage
Notre horizon de parures et d’or.
C’est Waterloo… Pardieu, que nous importe !
Quand l’étranger eut tiré les verrous,
On nous a vu entrer par cette porte…
Trémoussez-vous!
Çà, notre fête est brillante peut-être ?
Elle a coûté neuf cent vingt mille francs.
Qu’en reste-t-il ? Rien… sur une fenêtre,
Au point du jour, des lampions mourants.
Quand le soleil éclairera l’espace,
Cent mobiliers seront vendus dessous.
Vite, aux recors, calèches, faites place…
Éloignons-nous !








Commentaires récents