le petit karouge illustré
les babillages de Chinette, les coloriages de Chinou
Le Bœuf stroganoff

Finalement, il me faut constater que les vieux se sont bien adaptés aux progrès de la société moderne, depuis quelques décennies, et notamment à cet instrument désormais indispensable que constitue le téléphone portable. Ce n’est pas rien de le dire, encore faut-il le prouver.
Dimanche dernier, nous étions invités chez la mère de mon épouse. Vers neuf heures, alors que Suzanne et moi sortions à grand peine d’une douce nuit, moindrement réveillés par la lueur glauque des nuages moussus de pluie, le téléphone de la ligne fixe a sonné. Plus exactement, trois téléphones se sont mis spontanément en branle, chacun dévidant son propre jingle synthétique selon son emplacement dans l’appartement. C’était mamie Jeannette. On s’en serait douté, mais il faut laisser le hasard répondre seul comme un grand à cette question élémentaire : qui peut bien nous enquiquiner un dimanche matin, en pleine grasse matinée? Là, et dans ce cas précis uniquement, dans l’esprit de tout dormeur émergent mille visages cauchemardesques, susceptibles d’être LA personne dont on craint le plus l’appel, celle qui va vous pourrir la journée entière. Un échange rapide de regards entre Suzanne et moi l’ a faite immédiatement apparaître, bien dessinée dans la pupille, bien renversée dans la rétine de nos yeux allongés tournés vers le plafond du septième ciel, tout gris et goutteux, je le rappelle à l’attention des lecteurs qui voudraient se payer une petite tranche de ronflette supplémentaire en ce dimanche, eux qui n’ont pas de mamie Jeannette car ils sont devenus à leur tour des papis Poinpoin et, même bien adaptés aux progrès de la société moderne, restent incapables de commander une pizza par téléphone, avec une fiasque de chianti, car c’est jour férié, donc autorisation du médecin de famille à boire un petit coup, avec une lichette de tarte aux pommes maison déposée la veille par la gentille voisine du dessous dont les trois enfants en bas âge font un raffut du diable quand on refuse de satisfaire leurs caprices dont, notamment, celui de manger des pizzas avec du ketchup à la place du chianti.
C’est ainsi que pendant les dix secondes que dure la sonnerie, déboulent les visages de mon patron, à qui j’ai rendu vendredi des comptes mal ajustés, du curé dont j’ai vidé à vêpres les burettes, du commissaire qui me surveille pour délit de sale gueule sur ma carte d’identité biométrique, du juge qui me convoque pour avoir téléchargé des chansons paillardes sur internet, puis le capitaine Achab, le grand méchant Loup, la concierge du 20 avenue des Lilas, Fripou le banquier me menaçant d’un retrait définitif de ma carte bleue si je continue à passer des heures à me mirer dans la glace du distributeur automatique juste en bas de chez nous, alors que justement votre Honneur les reflets m’empêchent de lire l’écran que c’en est une calamité, puis les dix secondes de sons synthétiques s’achèvent et là, le cœur palpitant et donc le souffle haletant, Suzanne blottie contre moi, nous attendons dans le silence que le répondeur se mette en branle, et que résonne notre glas.
-« Oui, bonjour les enfants, c’est mamie Jeannette, j’espère que je ne vous dérange pas. Ma petite Suzanne, je suis ennuyée. J’ai prévu de vous mitonner un boeuf Stroganoff, mais j’ai perdu la recette. Je sais que tu l’as, dans tes fiches cuisine, celles qui sont au-dessous de l’étagère aux condiments, au dessus des casseroles. Bon, je te rappelle dans dix minutes, ma chérie, le temps que tu les retrouves. A tout à l’heure, et fais un bisou à Gigi de ma part!
-« Gilbert, ma mère te fait un bisou .
-« Envoie-lui un texto pour la remercier, et dis-lui qu’elle t’appelle sur ton portable, si elle ne veut pas épuiser son forfait (et son gendre). »
C’est ainsi que sans discontinuer, l’une le nez plongé dans sa fiche de cuisine et l’autre à concocter avec application la recette, avec des commentaires et des innovations sommaires ( je vais remplacer le paprika par du piment d’Espelette, ou: je vais rajouter des girolles aux champignons de Paris…), s’est passée la matinée. Entre le moment où le deuxième appel a retenti et celui durant lequel je suis allé à l’autre bout de la ville chercher le gâteau, la conversation n’a pas cessé, entre rappels et textos, relectures du livre ( mais non, maman, pour le bœuf Stroganoff, l’idéal c’est du rumsteack, prends celui du congélo, ne sale pas trop, limite le beurre et la crème fraîche, Gilbert suit un régime, etc etc). Et j’imaginais la mamie affairée sur son plan de travail, les doigts et le portable maculés de piment et d’huile d’olive, roulant les lanières avec ses grosses mains de boulangère à la retraite, toussant dans le faitout, assaisonnant le tout d’éternuements sous l’effet des odeurs épicées, les yeux rougis par le petit verre de vin rouge rajouté à la sauce (une innovation de plus), le front noyé dans la vapeur de l’eau bouillonnante pour cuire le riz ( dis-moi, Suzanne, je mets quoi, comme riz, du bashmati ou du camargue, mais non, maman, je te l’ai dit mille fois, tu prends le riz complet qui est sous l’évier, ça fait deux ans que tu l’as en stock, utilise le donc, bon sang, c’est pour cette raison que je t’ai dit que le bœuf Stroganoff était une bonne idée, c’était pour agrémenter ton riz, tu n’écoutes pas ce que l’on te dit…).
Finalement, c’est la batterie du portable de mamie Jeannette qui a flanché. La conversation s’est arrêtée net, alors qu’elle attaquait la phase finale. Un temps, Suzanne et moi avons songé que :
Hypothèse un: le portable avait plongé par désespoir dans la casserole d’eau bouillante
Hypothèse deux : la mamie l’avait suivi, mais en passant par le faitout.
Puis les trois téléphones de la ligne ont vibré, puis vrombi et envahi toutes les pièces. On se serait cru à Ibiza, avec David Guetta. Une transe.
Mamie Jeannette s’excusait. Le chat avait renversé le faitout en essayant d’attraper un nuage de vapeur qu’il avait dû prendre pour une grosse souris. Le repas était fichu. Elle était désolée. Je pris le téléphone des mains de Suzanne, réconfortais mamie Jeannette : c’est pas grave, mamie, au moins le chat Matou aura de quoi manger pour la semaine. Bon, écoutez, on a le gâteau, on arrive. Vous n’avez qu’à commander une pizza, en attendant. Je vais vous donner le numéro, ne quittez pas…
AK Pô
18 03 12

25 mars (hier mais rien ne presse) journée nationale de la procrastination !

Si vous ne le saviez pas, ce n’est pas grave. C’était hier. Prenez le temps pour toute chose, (remuez sept fois votre langue avant de parler, remettez l’horloge du changement d’heure à dimanche soir, laissez l’herbe du jardin pousser -de toute manière, il va pleuvoir et c’est pas bon pour les tondeuses-, immobilisez le virus en ne bougeant pas le moindre petit doigt, laissez la vaisselle s’accumuler dans l’évier, laissez les ours se réveiller fin avril, rigolez sur les porte-conteneurs bloqués sur le canal de Suez, faites la grasse matinée avec votre chérie, ignorez la marche du temps qui nous mène vers le précipice climatique et moral, pratiquez les gestes barrières pour n’en franchir aucune qui vous donnerait le sentiment d’aller plus vite que la musique…)

Journée de la procrastination
Devoir à rendre, rapport à boucler, facture à payer… autant de choses à faire que l’on risque de remettre au lendemain. Peut-être pour aller participer à la première journée mondiale de la procrastination.
… et si c’est pas aujourd’hui, ce sera demain. Peut-être !
Voici l’hymne sans contestation possible :

Maman, les gros bateaux qui vont sur l’eau…

Aujourd’hui, nous parlerons d’une croisière, avec 1610 bovins à bord…


On connaissait la Sartine qui avait bloqué le port de Marseille, mais là, c’est un cran au-dessus !
Un énorme porte-conteneurs de 400 m de long se trouve actuellement coincé en travers du canal de Suez, empêchant tout passage sur la voie navigable.
Un porte-conteneurs géant bloque actuellement le passage de tous les navires sur le canal de Suez. Le trafic maritime se trouve par conséquent à l’arrêt sur l’une des routes commerciales les plus fréquentées du monde.
Le cargo, en provenance de Yantian (Chine) mais battant pavillon panaméen, circulait en direction de la Méditerranée pour ensuite rejoindre Rotterdam, aux Pays-Bas, lorsqu’il s’est échoué sur l’une des rives du canal, avant de se placer en travers et d’obstruer la voie navigable.
Une photo publiée mardi montre le MV Ever Given, un navire taïwanais long de 400 mètres et large de 59 mètres, en travers du canal et empêchant tout trafic.
« Le porte-conteneurs s’est échoué accidentellement, probablement après avoir été frappé par une rafale de vent », a déclaré à l’AFP la compagnie Evergreen Marine Corp.
La compagnie « est en discussions avec les parties concernées, y compris l’Autorité qui gère le canal, pour assister le bateau dès que possible », a-t-elle indiqué.
L’agence Bloomberg a indiqué qu’à la suite de l’incident, plus de 100 navires étaient en attente de pouvoir emprunter le canal de Suez. « Il y a eu un incident d’échouage », a déclaré à Bloomberg Alok Roy, directeur de BSM Hong Kong, qui gère l’Ever Given.

Les mardis de la poésie : Morice Benin (1947-2021)

Paroles et musique !
Biographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Morice_Benin
Extrait :
Moïse Ben-Haïm naît à Casablanca1, après la guerre, son père — qui a émigré en France — obtient la francisation du nom de famille. Pour ses premiers albums, il utilise dès lors un prénom également francisé et son nouveau nom : Maurice Benin.
En 1976, sur la première version de l’album C’était en 1976, la forme Môrice Benin apparaît. Ce n’est qu’en 1980, avec l’album Passage, que l’accent circonflexe disparaît définitivement et que le nom Morice Benin se stabilise2.
Il écrit ses premières chansons à l’âge de quatorze ans, mais le choc « originel » remonte à Jacques Brel, découvert au Théâtre municipal de Casablanca en 1962, et qui incarnera sa ferveur à pousser la voix lui aussi, à considérer la chanson comme un art majeur. Vinrent ensuite tous les autres « pères spirituels » : Georges Brassens, Félix Leclerc, Claude Nougaro, Gilbert Bécaud, et surtout Léo Ferré, lequel accompagnera plus tard toute une partie de sa génération.
À l’été 1965, Maurice débarque à Marseille pour les vacances… et n’utilisera jamais son billet de retour. Il « monte » à Paris pour tenter sa chance, sans un sou en poche mais avec beaucoup de motivation, et aussi quelques illusions : petits boulots pour survivre et grand blues de la capitale, mais la motivation s’en sort à peu près indemne.
Mourir dans un fauteuil, quel cinéma papi !

Il venait d’acheter un fauteuil assez confortable, et quand il me fit asseoir sur la banquette en bois, une vieille pièce de chêne ouvragée qui, disait-il avec malice, provenait de l’arbre où d’Artagnan attachait jadis son cheval, ce qui, avant que ma femme ne parte avec un autre étalon, me faisait sourire, je compris que désormais je n’avais plus en face de moi un vieil ami, mais un vieil homme. Certes, son visage éprouvé par l’existence, les rides qui s’émancipaient du front pour flétrir le sourire, les joues qui amassaient sur son visage des rondeurs enfantines, tout ce que la vieillesse devient plus vite que ce que la jeunesse sans futur aucun exclut par principe immédiat s’offrirent à mes yeux voyous, car le fauteuil présentait plus d’attraits que ce faciès de vieillard assis, face à moi, qui le devenais aussi.
Il avait grossi, devenait énorme. Je me souviens d’une phrase qu’il m’avait dite, à laquelle je n’avais prêté aucune attention particulière : « – quand l’imaginaire ne remplit pas ta pensée, tu grossis comme un sac de patates, parce que les patates sont prêtes à tous les sacrifices, pas la pensée ». La pièce sentait le tabac. Son sourire goguenard me toisait du coin de l’œil, cet œil noir qui validait bien des précipices, et une longue série de maîtresses évanouies dans le néant de sa vie. Il voulait me voir. Pourquoi, je l’ignorais. Voulait-il donner un corps à la vision de sa solitude, comme d’autres s’offrent le reflet des verres vides à la leur, je ne sais, mais c’est le fauteuil, assez confortable, qui attira mon attention, pas l’homme affalé dedans.
Nous échangeâmes des regards furtifs, quelques mots coutumiers, des souvenirs tournés depuis vers leurs futurs et devenus, à leur tour, Passé. Le monde du travail et l’horizon des barbelés qui couchaient sur la mer un soleil éteint, mais si chaud en journée. Nous parlâmes sans enrôler nos âmes et pourtant, chaque mot couvrait la planète d’un fin tissu de soie, de parcours gigantesques cheminés à petits pas, de lettres d’Orient acheminées à la poste restante de Londres, de tuyaux parcheminés de télégrammes à Paname, de cheminées en hauts fourneaux éteints, nous parlions de nous taire simplement nous souvenir.
Il s’assoupit. Lâcha un pet, puis : « j’aimerais être un chat de gouttière, plutôt qu’ à présent un homme d’hier. Tu vois, je voudrais être au final une petite cuillère, un verre d’absinthe, qui raconterait la soif de vivre, le goût vert de l’eau, plutôt que de vivre le petit doigt en l’air, en disant à mes visiteurs, c’est beau, n’est-ce pas ? J’aimerais, je ne peux pas ».
Les hommes sont compliqués, mais quand ils vont mourir, tout s’éclaircit. Trahisons, amours, ambitions, craintes de mourir anéanties, sans traces, illusions des mémoires scellées sur des tombeaux de marbre, de pierre, oubli de l’homme, pogrom, disparition. Enfer. Il me dit : « tu es jeune, encore, as-tu enfin trouvé une femme, qui s’occupe de toi? »
Je lui réponds: » oui, une femme, j’en ai trouvé une. »
Mais je ne lui dis pas que c’est elle que j’ai vue, dans le fauteuil assez confortable. Non, je ne le lui dis pas. Cependant, ces rondeurs grassouillettes que sa position impose excite un désir en moi que j’ignorais jusqu’alors. Rondouillard, enfiévré, son corps mollement exposé m’attire. Mon idée chemine, perverse : m’a-t-il invité par simple courtoisie ou, par abjection? Se sent-il renégat d’un monde duquel il s’absente ou, par allégorie, souhaite-t-il que de son fauteuil étant un amour étrange mais bien réel surgisse ? Est-il vieux sous les combles ou jeune sous la petite mort qui l’attendrait sans ne jamais l’atteindre, par un assaut viril et fugace de ma part. Les deux, mon général. Il me tend sa main droite, tremblante, une peau de lézard mal réchauffée au soleil, une peau qui a envie de fuir son terremoto sensoriel, une peau sèche. Je la saisis. La pose sur mon sexe. Mon sexe est plus froid qu’un fauteuil confortable dans un salon où je ne peux survivre sans femme. Dans sa main cependant ma pine grossit, car il faut au vieillard un souvenir de vie, un espace légué à la concupiscence de ce qui a été et sera pour les autres, un acte de générosité, pour qui ne sait quoi.
Il commence à me branler, s’endort. Je baisse les yeux : tout est mort. Son bras, ses doigts, mon sexe. Seul un sourire, sur son visage. Les ridules ont disparu, les cernes et tous ces scolopendres qui pourrissent dans l’ombre pour mieux ressurgir à l’automne, tout a disparu dans le sommeil. Et le fauteuil est là. Nu, mauvais, méchant. Noli me tangere. Tous les parfums du monde soudain s’y sont attroupés, odeur de saucisson, de deuil, d’encens miséricordieux. Le fauteuil où une femme lèvera ses deux jambes graciles, son cul chantant, au grand dam de d’Artagnan, avec son chêne multicentenaire, qui ferrera son cheval, sans penser à mon père, qui est bien plus vieux que le fauteuil dans lequel il ne s’est jamais assis.
AK Pô
06 06 12
Page 2 : comment le récit invite de nouveaux personnages

De comment le récit invite de nouveaux personnages à venir…
Résumé : Après deux années passées à Venise, Guido et John ont décidé de partir à l’aventure, avec sous le bras leur histoire commune. Ils atterrissent en France, dans les Landes, chez un dénommé Carlyle, tenancier de bistrot ayant lui-même fui Venise, se rendant compte que le tourisme de masse massacrerait les lieux, poussant les autochtones à quitter la Sérénissime pour les HLM pollués de Mestre. Installés dans le bistrot, ils consultent leurs notes…
« – je viens de relire ce monceau de feuilles et tout cela manque de corps », dit John qui semblait véritablement épuisé. Guido le regardait d’un œil morne, compatissant. Il finissait en réalité de cuver l’alcool qu’ils avaient ingurgité, la nuit durant, chez Carlyle le bougnat, dans son estaminet de Mimizan, quand les thèmes rémanents de leur discussion s’étaient lentement dissous dans un long silence de verres vides.
Guido hocha la tête mollement quand John reprit :
« -En conclusion, je pense qu’il faut faire un sacré ménage. Il faut virer des trucs pour conserver une certaine logique. Toi, Guido, je te virerais bien. On en connaît plus sur ton scooter que sur toi. A quoi ressembles-tu ? Grand, petit, gras, maigre, on ne sait pas. Mais tu es mon pote, je ne peux pas te mettre au rancard; de plus, tu fais partie intégrante de ton engin, comme Diane de Montrouge sur sa mobylette orange chantée par Nino Ferrer, t’es immortel quelque part, mais va falloir te mettre un peu en avant, garçon, si tu veux que ça avance ! »
Guido eut un large sourire, découvrant ses dents jaunies par la nicotine, et les ridules aux commissures de ses lèvres épaisses marquèrent leur territoire d’un brin de malice. Qu’on le mît à l’épreuve n’était pas pour lui déplaire. Il n’avait en effet jusque là pas même répondu à la question : « voyons, Guido, ça n’a pas d’importance, si ? » et il se sentait prêt à des réponses multiples, cohérentes, ouvertes sur les jardins de la ville basse comme la marée girondine sur le ciel jacobin.
« – Donc, je résume, repartit John. Charité bien ordonnée commence par soi-même ; donc j’endosse le rôle principal, je crée une copine, Charlène, fleur d’Écosse et pour toi ce sera Giulieta, c’est légitime. Tu aurais préféré Angélique, mais pour l’instant on la laisse au placard, elle ne sera utile que plus tard, quand l’intrigue se dessinera, d’autant que la présence d’héroïnes est nécessaire à l’émancipation des hommes, à leur éducation ; des femmes, donc, mais au compte-gouttes !
« – tu me connais, John…
« – si peu. On garde l’église, pas le curé, les balcons fleuris. pour parfumer un peu le récit d’autre chose que de pizza aux anchois, la piscine en pente de Miss Robinson, pour l’exotisme, il en faut pour tenir le coup, et les quais. J’adore les quais… » John marqua une pause, et regarda ses doigts potelés d’un œil rêveur. Pourquoi aimé-je les quais ? se demanda-t-il in petto. Mais son esprit reprit les commandes et la liste des admis-virés continua. Les mecs, maintenant. L’oncle Joé, avec son air con et ses blagues à cent balles, je garde. Le poète normand, aussi, mais à condition que ce ne soit pas un Bac +5, parce qu’il finirait par nous mener charrette avec des algorithmes en alexandrins. Si seulement il avait des racines yéménites, ce serait idéal, genre cultures du monde, le trou maori, le cidre romand, le délire papouasien, l’aubade écossaise… »
« – je suis d’accord avec toi, John, mais attention ! nous sommes dans une fiction. Or, dans la fiction, chacun a droit à sa part de délire, et là, tu fais fausse route. A cadrer le récit, tu enlèves toute spontanéité, tu brises l’échange doucereux et fantasque, au risque de mettre en pétard le lecteur (qui est à cet instant seul au monde), et tu sais comme moi qu’il vaut mieux l’éviter, pense à Beaubourg, tu te souviens ? On avait refusé de placer l’œuvre d’Angélique entre celles de Miro et de Kandinsky, et ça l’avait rendue furax, c’est même en te bousculant dans l’escalier que vous aviez fait connaissance ; à l’époque, c’est vrai, tu savais calmer les dames ! »
« -Ah, Angélique ! C’était une jolie plante, celle-là ! Mais tu as raison, Guido. Peut-être existe-il une troisième voie ?
« – je ne sais pas, répondit Guido. Remarque, on pourrait peut-être…
« – dis !
« – on pourrait concocter un poème sur le thème « un combat de coqs » ? Voir comment on s’en sort. Cette histoire est déjà si foutraque !
« – c’est une idée, admit John. Avec, par exemple, l’intrusion d’un Manx (à gagner) en plein combat, alors que le poète normand-yéménite a tout parié sur le poulet d’Aden et que soudain celui de Sanaa… »
« – y a plus qu’à… » s’exclama Guido, enthousiaste, alors que Carlyle rangeait tables chaises et boissons. La nuit tombe vite, à Mimizan, l’hiver.
AK
21 03 2021(modifs)
PS : impossible de retrouver la page 3…Va falloir turbiner, Pépère, pour liaisonner la 4, qui brûle déjà d’impatience !
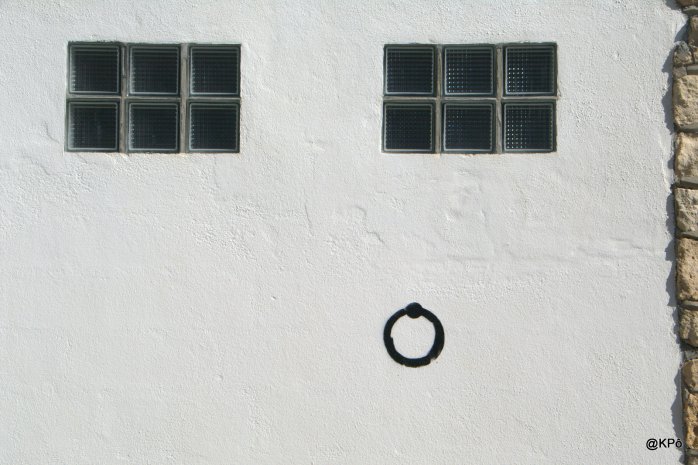
Page 1 : la rencontre de John et Guido

Retrouvée dans un disque dur, cette histoire compte une trentaine de pages, qui constituent un ensemble assez brut et certainement foutraque (vu que je n’ai pas relu l’ensemble). Cependant, cette mise en bouche suffira….pour l’instant ! Bonne lecture !

Les quatre premières années que John passa à Venise furent essentiellement consacrées à l’apprentissage d’une vie nouvelle, au franchissement de ce pont des soupirs qui mène de l’enfance à l’adolescence. Il découvrit la cité lacustre, ses îles, parcourut en famille les provinces alentours, de la platitude poétique du Po, avec sa nonchalance et ses digues plantées de bouleaux et de platanes, explora les monts Euganéens, s’entortilla sur les Dolomites pendant que sa mère Clara tricotait calmement et que son père Thomas, (rarement), conduisait sur la route en épingles à cheveux, entre Sanary et Cortina d’Ampezzo. Rarement, car Thomas Galopin fut très vite atteint d’un œdème pulmonaire et passa dès lors plus de temps étendu sur un des lits de l’hôpital civil du campo Santi Giovanni e Paolo Conté, que dans la Fiat Lux 500 achetée à crédit dans un garage de Mestre. Sa santé déclina rapidement, et il fut enterré le 28 mars 1976 dans un tableau d’Arnold Böcklin, « l’île des morts » (et non sur l’isola san Michele).
Il n’est chose plus terrible pour un adolescent que de perdre son père à ce moment-là, moment qui coïncide exactement à celui où la jeunesse se sent prête à affronter le monde défait des adultes, non pour en prendre la place, mais bien pour en combattre la trahison et la lâcheté. C’est ainsi que, désemparé, John commença à errer dans les ruelles vénitiennes, labyrinthe de pierres, de passerelles et d’ombres nues inondées de palais aux accès inaccessibles mais aux reflets aquatiques étonnamment sublimes. Sur le campo della Pescaria régnait une brume épaisse et froide en ce début novembre. Il devait être vers les quatre heures de l’après-midi et la clarté du jour tendait vers l’opacité du soir. Le pont du Rialto, un peu plus loin, était presque vide de chalands et la plupart des boutiquiers avaient plaqué leurs volets de bois sur les vitrines. Le vent âpre des Alpes caressait les canaux, se frottant aux murs vétustes des immeubles riverains du palais Ca d’Oro, de l’autre côté du Grand Canal.
C’est là que John rencontra Guido, menant avec maestria son diable à trois roues caoutchoutées, en étoile, très efficace pour monter et descendre la multitude de petits escaliers virevoltant au-dessus des canaux. Posées sur les cornes du diable des cagettes vides soubresautaient entre les dalles de pierre polies, lorsque, par un geste malencontreux, ou du fait de la présence d’un carton plein de canettes de coca cola à demi éventrées vampirisant l’espace, la cargaison s’étala sur le sol humide. John arriva à la rescousse pour aider le livreur embarrassé. Ainsi débuta leur amitié, dans la ville des Doges et de l’aqua alta, par une fin d’ après midi sans charme, sur le campo Beccarie.
Bien plus tard, quand ils seraient à bavarder ensemble dans une autre contrée, dans un estaminet dirigé par un dénommé Carlyle, John se souviendra de cet extrait de « Venises », de Paul Morand :
» Ils n’avaient pas été Rimbaud; ils ne seraient jamais Gide, qu’ils détestaient, ni Giraudoux, qu’ils lui préféraient, ni Proust, peu connu. Gide, Giraudoux, Proust avaient eux aussi porté la moustache longue; désormais, ils la rasaient ou la taillaient courte.
Hommes très charmants, sans grande confiance en eux-mêmes, dandys amers et doux, vite amusés ou désespérés, moquant les invertis, comme ce héros de Thomas Mann, ce Herr von Aschenbach troublé devant l’épaule nue qu’un jeune baigneur du Lido ose laisser voir hors du peignoir de bain !
Les femmes les avaient fait souffrir (pas de chance, ils avaient eu affaire aux dernières femmes qui feraient souffrir les hommes). Etre fiers, fins jusqu’à se briser, avec des nerfs en verre filé de Murano; réfugiés dans la Cité-refuge, bousculés par la vie, par un public grossier, pas encore à la fois averti et snob, par des éditeurs encore avares; ils n’aimaient la richesse que chez les Rothschild, où ils dînaient, mais pas pour elle-même. »
Guido avait quinze ans, un an de moins que John, une stature de commis de cuisine, pas très grand (1.70m) mais assez carré, les bras musclés et des fesses larges qui lui donnaient, de dos, un aspect agréablement féminin. Le sommet de son crâne s’ornait d’une belle touffe de cheveux blonds, ce fameux blond vénitien aux reflets roux, coiffés en arrière et tenus par un zeste de gomina (en réalité du savon). Son visage était ovale, avec deux lèvres formant une moue qui rappelait l’accouplement de deux limaces dans les replis d’un sourire. C’est d’ailleurs cette particularité qu’appréciait le plus John, lui qui mesurait un mètre quatre vingts, silhouette efflanquée et fesses moulées dans un jean 501, avec sa caboche d’écossais parsemée de taches de rousseur, le teint rose trémière, par tous temps, sauf en été, quand le soleil brunissant sa peau jusqu’à ne plus en distinguer les éphélides. Il était brun touffu, le cheveu lisse et soyeux. La timidité de Guido formait le contrepoint parfait de l’exubérance, surtout imaginative, de John.
Comme tous les adolescents, ils rêvaient de refaire le monde loin de l’image que leur en donnaient leurs parents, et s’inventaient des parcours dans lesquels ils avaient l’ambition de s’aventurer bientôt. Ainsi Guido, né à Mestre et vivant depuis toujours à Venise, soupirait souvent en parlant de Cesare Pavese, du Piémont et de Gênes, (la route de l’Ouest) quand John lui préférait Pasolini, qui avait quitté les rives du Po pour Cinecitta et une carrière cinématographique hors du commun (la route du Sud). Ils déliraient aussi sur Cormac Mac Carthy, et se voyaient cow boys sur les collines métallifères, entre Follonica et Grossetto, menant les troupeaux de vachettes cornues tout en chevauchant des chevaux de Prjevalski. Pour ces raisons, Guido, qui suivait avec passion une formation de mécanicien, travaillait certains jours de semaine et les week-ends comme livreur chez un limonadier du quartier de l’Arsenal, avec la ferme intention de s’acheter un scooter, véhicule dont il était frustré depuis toujours, mais dont il avait vu de multiples exemplaires piazza di Roma. John, on ne sait par quel hasard, (mais sans doute par Clara, sa mère, qui donnait des leçons de tricot aux bourgeoises de la calle Zugna, dans le quartier San Elena, où ils habitaient depuis son récent veuvage) dégota une place d’employé (à temps partiel) à la billetterie sur la ligne de vaporetti allant de l’Arsenal à l’aéroport Marco Polo. La fréquentation massive de touristes transitant par cette ligne incita John à apprendre le français, l’espagnol et l’allemand, langues pour lesquelles il ressentait une certaine facilité d’assimilation.
L’avenir était en marche, et l’amitié y menait.
AK Pô
26 08 12

JR éventre la façade du palazzo Strozzi à Florence !

Extrait de l’article de Sud-Ouest (source AFP) :
« Alors que les musées italiens sont à nouveau fermés pour cause de pandémie, l’artiste de rue français JR a offert vendredi au public en mal d’œuvres d’art une ouverture de musée à Florence, façon « Street Art ».
« La Ferita » (la blessure), dernière œuvre de l’artiste français JR, est un trompe-l’œil mural monumental en noir et blanc représentant un trou béant creusé dans la façade du Palazzo Strozzi, palais des XVe et XVIe siècles, connu pour ses expositions d’art contemporain.
Au-delà de cette brèche fictive, le spectateur peut apercevoir certaines des œuvres les plus connues de la cité toscane que sont La « Naissance de Vénus » de Botticelli et les corps de marbre tordus du « Viol des Sabines » de Giambologna.
« C’est un message qui arrive à un moment où nous avons besoin d’une ouverture des musées » a déclaré JR vendredi lors du dévoilement de l’œuvre, ajoutant que l’art de rue pouvait apporter un certain soulagement avant « la vraie réouverture des musées ». »
(photo Alberto Pizzoli, AFP)

Ça fait du bien !

Main basse sur la pub

J’y suis pour rien !
C’est mercredi , ici, dans le petit pays : le facteur passe généralement vers midi. Alors, par précaution, on fait une première tentative vers 12h15, puis une autre vers 12h45. Des fois les lettres s’envolent mais jamais les publicités que ce pauvre diable sympathique déverse dans notre boîte. A vrai dire, c’est le régal de Josépha, qui les épluche tout en pelant les légumes. Il se trouve dans ces packages de papier des pacages de rêveries alléchantes, des promotions et réductions qui brillent sur les images que d’humbles photographes, pour gagner leur vie, flashent et refourguent pour un bout de pain ou un slip de bain, qui le sait, à des industriels qui les font cataloguer par d’obscurs imprimeurs et les distribuent ensuite, grâce à de petites gens mal payées, dans les boîtes aux lettres ou par la Poste, ex-service public déliquescent.
Aujourd’hui, c’est mercredi. Je tends la clé du Sésame à Josépha. Joël, ce n’est pas le moment, j’épluche les nouvelles du monde sur internet, vas-y, toi !
Je suis assez rétif. Une fois, j’ai trouvé une grosse araignée dans le caisson métallique. Puis les factures, Eau, EDF, assurances multiples, bref moult calamités qui rendent cette caisse maléfique. Cependant, en héros du XXIème siècle, tenant la petite clé à bout de bras, je suis allé tel le preux chevalier Don Quichotte percer l’outrance de cet ennemi : la Pub (et non le Pub, que je fréquente plus que de raison). J’ai tourné la petite clef (sachant que l’ennemi pouvait faire la même chose depuis le trottoir, et sans surprise une cataracte de prospectus m’inonda. J’hésitai à plonger ma main dans cette marée de papiers recyclés, mais, par amour pour Josépha, je fis ce qu’aurait fait le preux chevalier, je moulinais mon bras pour vaincre les fantômes.
Alors que le petit conteneur était presque vide, une main apparut dans l’interstice, cette étrange ouverture où l’on plonge les courriers stéréotypés, les tracts publicitaires, les lettres anonymes et, parfois, les menaces de mort. C’était la main droite du facteur. Celle avec laquelle il nous tend ses recommandés ou ses petits paquets à signer sur une mini tablette. Je connais bien cette main, elle porte une fausse alliance à l’annulaire et une bague à tête de mort au majeur. Notre préposé est un motard. Nous en avons souvent parlé. Mais pour son travail, c’est tricycle électrique. Frustrant, mais comme il le dit faut bien gagner sa vie, même à trente à l’heure !
Sur le trottoir, des traces de sang encore fraîches. La main est coincée, encore tiède. Je file dans le garage chercher une petite meuleuse et découpe l’opercule pour sortir le membre, puis je l’enveloppe dans le pack de publications, noue un torchon (un mouchoir en fait) et crie à Josépha : vite ! Appelle les pompiers, le SAMU, les gendarmes, le facteur a laissé sa main dans la boîte à lettres !
Elle s’exécute, et vient à moi en courant : « le toubib du SAMU dit que c’est une plaisanterie ! « Je lui prends le téléphone des mains et clic clac j’expédie une photo au médecin incrédule. Réponse : « ce n’est pas une main de facteur, monsieur, elles sont beaucoup plus larges que les orifices des boîtes à lettres standardisées ! Arrêtez votre cinéma, nous n’avons pas que ça à faire ! » et il raccroche. Pendant ce temps la main soubresaute dans la mienne. Elle semble s’impatienter. « Va chercher le calendrier dans le tiroir de la cuisine, Josépha, pas celui des pompiers, celui de la Poste, ne te trompes pas, cela risquerait d’être fatal pour elle. »
Elle revient trente secondes plus tard. La main saisit le carton avec vigueur, le caresse, reprend vie. Ses doigts sont caressants mais la force lui manque et le calendrier tombe à terre. Pour la première fois je vois sa paume. Y est inscrit un message tatoué à l’encre d’imprimerie : « monsieur, vous n’avez pas été généreux l’an dernier, alors rendez à César (c’est le prénom du facteur NDLR) cette main que charitablement je vous tends, en y plaçant un beau billet de banque. »
Tout à coup, la main se replie et se transforme en poing. Je prends peur face à la menace qu’elle paraît augurer. « Josépha, vite, retourne dans la cuisine et allume le four thermostat 7 ! »
Au même instant, sur le côté impair de la rue, je vois César sur son tricycle électrique enfourner courrier, publicités et petits colis comme si de rien n’était. Il me fait la gueule, c’est certain, et pourquoi ? Devinez, l’an dernier je n’ai pas été assez généreux pour ses étrennes, mais bon sang, je ne suis pas Crésus, juste un peu Don Quichotte dans mes élancements. Ah ah, mon gaillard, eh bien ta main elle va finir dans le four et nous dévorerons jusqu’aux os : pouce, phalanges, paume, tarses, métatarses et sa sœur elle battra le beurre, les ongles aux claires lunules nous serviront de cure-dents, non mais !
Josépha a mis la main dans le four, après en avoir ôté la fausse alliance et la bague à tête de mort. A présent elle feuillette les pubs en attendant que le repas soit prêt. Parmi toute cette paperasse étalée sur la table, elle trouve et me tend une lettre qui m’est personnellement adressée. C’est un courrier à en-tête officielle de la gendarmerie. Il m’informe que, suite à de nombreuses incivilités à son encontre, le facteur a déposé une plainte, qui a été enregistrée sous la forme d’ une main courante.
A table, mon chéri !
C’est délicieux, mon amour !
19 03 2021
AK
«
Sur la terre, face au ciel, tête en l’air, amoureux,
Y’a des allumettes au fond de tes yeux,
Des pianos à queue dans la boîte aux lettres,
Des pots de yaourt dans la vinaigrette
Et des oubliettes au fond de la cour…
Comme un vol d’hirondelles échappées de la poubelle des cieux…



















Commentaires récents