le petit karouge illustré
les babillages de Chinette, les coloriages de Chinou
Les œufs cuisent-ils plus vite quand sévit la canicule ?

Le beurre fondait comme l’argent et l’avenir de Jean, qui pensait qu’avec son magot il passerait au soleil le restant de ses jours. Le beurre demi-sel brunissait au fond de la poêle où il cassa et plongea deux œufs, le seul plat qu’il savait cuisiner sans avoir vraiment appris qu’en cassant ces œufs il aurait pu battre les cartes d’une omelette, en y ajoutant sel poivre et quelques grammes de fromage râpé pour la rendre plus goûteuse. Hélas, il n’avait plus un rond pour acheter quoi que ce soit, et les deux œufs noyés dans le beurre noirci le narguaient. Ils semblaient lui reprocher d’être un raté, un type incapable d’assumer le braquage de deux poules de luxe qui sortaient de chez Van Cleef et Arpels©, les célèbres joailliers de la place Vendôme, en ce mercredi de juillet caniculaire. Ces femmes avaient la nuque bien dégagée et de leur cou pendait un collier comme on les aime dans la haute société des gens qui se foutent du monde. Jean les avait attaquées de dos, déclipsé leur monture et d’un revers de main arraché les pendeloques, avant de s’enfuir en Scooter© dans les rues de Paris, celles qui ne sentent pas le parfum des beaux quartiers. Tout en roulant il comprit ce que signifiait la fable de « la poule aux œufs d’or », alors que coulaient les deux rivières adamantines dans la poche de son veston. Il remercia son ancêtre Jean de la Fontaine, songeant que cette fable était d’une autre valeur que celle de Perrette et son pot au lait. Mais le destin réunit souvent les espoirs déçus, comme ce fut le cas pour Jean, son avenir et ses œufs au plat.
Une fois rentré chez lui, il admira le scintillement des bijoux sur la table de son studio du sixième étage. C’était beau, mais ce n’était pas tout : il fallait les fourguer à un receleur, et il n’en connaissait pas. Il avait agi par opportunisme, simplement parce qu’il était présent là, place Vendôme, dévorant un sandwich pendant sa pause de coursier sur le siège de son Scooter© (qui n’était pas un Piaggio©). Finalement, il opta pour les puces de saint Ouen et s’y rendit le samedi matin, jour non ouvré mais ouvert aux petits trafics illicites. Il fit la tournée des brocanteurs, antiquaires, vendeurs de montres et de bibelots chinois. Tous lui répondaient qu’en fait, sa marchandise était du toc, ni plus ni moins, tout juste bon à intéresser quelques rappeurs qui adoraient le clinquant les lunettes noires et les manteaux synthétiques en faux renard des toundras sibériennes. Comme il s’épuisait à ne trouver aucun potentiel acheteur, il brada les bijoux à un ruffian vêtu comme un duc, un nommé Roland Dorgelès, qui lui laissa sa carte de visite et l’invita le lendemain dans un boui-boui de Montmartre, où il avait son QG. A midi trente, alors que sonnaient les cloches de la basilique du Sacré Cœur, sur la Butte, Jean pénétra au restaurant chez Plumeau, où Roland l’attendait, installé à une table en retrait. Ils déjeunèrent d’un hamburger frites (cuisson belge) et d’une glace américaine au parfum pistache (sans pistache), puis se mirent d’accord sur le montant de la vente : cinquante euros par pièce. Jean accepta, noyé par le baragouin du duc et les verres de mauvais rouge qu’il avait ingurgités, éberlué par la faconde de son acquéreur. Roland offrit le pot de vin et tendit sous la table un billet de cent euros, pendant que Jean lui tendait, de l’autre main, le paquet de bijoux enveloppé dans la gazette de la Butte Rouge, un vieux journal communiste qu’il venait de trouver au pied d’un peintre amateur qui essuyait ses pinceaux avec.
La transaction effectuée, le duc s’éclipsa, laissant à Jean le soin de payer la note sauf le vin, qui en fait était compris dans le menu. Tout heureux, Jean remonta sur son Scooter© et redescendit la Butte jusqu’à la rue Ordener. Il trouva une station service et refît le plein, avant de regagner son domicile, avenue d’Orléans. Il s’arrêta deux ou trois fois boire une bière sur le parcours. La canicule de ce mois de juillet était véritablement intense, ce qui justifiait à ses yeux ces arrêts, bien qu’il ne conduisît pas la bouche ouverte. Arrivé au pied de son immeuble, il cadenassa son engin autour d’un lampadaire qui sentait le dog day new yorkais, puis courut chez l’épicier arabe ouvert sept jours sur sept acheter du beurre, des œufs, du fromage râpé et une bouteille de Gevrey Chambertin ( en promo car tombée du camion). Avec les faux frais, l’essence et le restau, lui restait un billet de cinquante et trois euros trente en pièces. Le commerçant glissa le billet dans une petite machine aux reflets verdâtres et lui signifia qu’il était faux. Bref, la poisse, comme Perrette. Il paya avec sa monnaie et repartit avec une boîte de six œufs et une plaquette de 125 grammes de beurre (demi-sel, car il était breton).
Le lendemain, lundi, le Scooter© ne démarra pas et son absence au poste de travail dans les délais impartis fut considérée comme une faute grave chez son employeur, Hubert Allès. Il fut licencié sur le champ. Pas d’indemnité, fallait être à l’heure mon gars ! Lui répondit-on par texto. C’en était fini de l’avenir, du magot et de la belle vie au soleil des tropiques. Il lui faudrait trouver un autre esclavage. Pour cela, il lui fallait lire les petites annonces dans son Smartphone© connecté, qui était sa seule richesse et son unique potentiel pour dégoter un boulot. Plongé dans ses recherches tout en cuisant ses deux œufs au plat (sur six) qui le narguaient dans la friture, il fut attiré par un gros titre dans le journal ;
« Un vol stupéfiant a eu lieu mercredi dernier place Vendôme. Deux poules de luxe se sont faites dérober leurs colliers d’une valeur de soixante cinq mille euros ( certes, du bas de gamme) à la sortie de la joaillerie Van Cleef et Arpels©. Le voleur présumé est toujours en cavale, mais les journalistes de BFM TV© enquêtent sur une piste que leurs propres caméras de surveillance constante de l’actualité ont semblé déterminer. Il s’agirait d’un jeune homme mangeant un sandwich dont on ignore pour l’instant avec quels ingrédients celui-ci était composé. L’auteur du vol était assis sur un Piaggio© de couleur rouge. Les investigations continuent. »
Jean reposa son portable. Les yeux des deux œufs avaient changé de couleur ; de jaunes ils étaient passés au blanc. L’air de dire on est là, maintenant on a compris que tu as eu raison de tenter ta chance, même si tu es quand même le dernier des cons.
18 07 2022
AK




Canicule et bascule

Nous passions un long moment caniculaire. Rebecca commençait à fondre, et ce n’étaient pas les médocs qu’elle avait achetés sur internet à prix d’or qui y étaient pour quelque chose. La chaleur fait fondre la graisse, et pour ce faire, moi, Daniel son mari, lui ai proposé d’aller bronzer dans le transat du jardin. Je la massais avec une pommade bio sur son corps exposé mais non muséal. Auparavant, je lui avais enjoint de se peser sur la bascule, afin de comparer l’impact du soleil et celui des cachetons pour maigrir. Elle resta trente et une minutes avant de revenir en trombe dans la maison et se précipita sous la douche tiède. Je lui demandai de mettre une bassine sous ses pieds et de ne pas se savonner, juste frotter son corps avec ses doigts. Sa peau en sueur ressemblait à un marais salant et je pus récupérer la bassine à demie pleine, la sortir à l’extérieur pour que l’eau s’évapore et qu’il ne reste que la fleur de sel fournie par sa sueur après dessiccation.
La chair de Rebecca, sous la demi-heure passée au soleil, avait pris la couleur des crevettes dont se nourrissent certains échassiers pour maquiller leurs plumes dans les rizières de Camargue. Cependant, la serviette posée sur le transat ne comportait plus que quelques maigres traces de gras, et je rageais intérieurement de ne pas être allé la retirer dès que Rebecca avait quitté le siège. Le gras avait fondu et des mouches finissaient de boulotter le peu qu’il en restait. Elle prit deux cachetons (sa cure d’amaigrissement) avant de s’installer sur la balance pour continuer l’expérience. Le résultat frôlait l’égalité. Puis elle revînt et liquida un demi-litre d’eau gazeuse ; je lui avais dit cent fois que le gaz contenu dans l’eau ne fait pas plus maigrir que les épinards sans beurre, mais elle disait se sentir plus légère, comme si elle avait bu quelques coupes de champagne. Face à ce point de vue je ne possédais aucun argument, tant les bulles de ce plaisant breuvage me faisaient le même effet.
Vers dix sept heures nous atteignîmes le pic de chaleur tant redouté : 40° à l’ombre. Bien au-dessus des températures de nos masses corporelles. Nous nous mîmes d’accord pour sacrifier le contenu du frigo et du congélateur. Bien calfeutrés dans la cuisinette, nous ouvrîmes en grand les deux portes du meuble électroménager et fîmes tourner les pales du ventilateur acheté chez Centrakor, un balayeur d’air peu puissant mais, placé stratégiquement face au réfrigérateur il pulsait un air sibérien. Avant que les glaçons ne fondent, nous nous préparâmes un Gin fizz et avalâmes quatre cônes de glace réservés habituellement pour les soirs devant la télé. La température chuta de quelques degrés et nous redonna temporairement goût à la vie, l’ancienne, l’anté-caniculaire.
Pendant ce temps les incendies ravageaient la Gironde et le Sud de la France. Et nous, Rebecca et moi, nous gobergions et profitions d’un endroit clos rafraîchissant pour oublier le monde, le réchauffement climatique, les inondations, la grêle, les tempêtes, les vagues d’exilés meurtris, affamés, assoiffés, la disparition d’espèces animales (car il n’y avait plus assez d’eau pour faire flotter l’arche de Noé). Et soudain, panne générale : plus de jus, plus d’eau, plus de gaz, plus d’internet, plus de Rebecca, juste un brouillard épais qui sentait la pinède calcinée, un court-circuit géant répandu sur toute la planète. C’est à ce moment-là que je fis rentrer les chats dans la maison : sur le perron, ils grattaient et étouffaient. Rebecca avait fondu dans mes rêves (sadiques?), il ne restait qu’eux et moi. À présent totalement hagard face à ces catastrophes qui s’enchaînent, n’osant pas mettre les pieds dehors par crainte d’être dévoré par l’ignoble chaleur, je réfléchis à qui je pourrais vendre, plus tard, l’iode de la sueur des hommes, femmes et enfants, qui combattent les feux, tous les feux, ici, ailleurs, partout, comme nous tous, qui sommes le sel de la Terre :
« Nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. » (Matthieu)
17 07 2022
AK




La rafle du Vel d’Hiv a 80 ans…Roulez jeunesse ?

Écoutez le témoignage de Rachel Jedinak, sur France Inter.
minute 29.40s de l’émission.
Jamais je ne soutiendrai les partis extrémistes, qu’ils soient fascistes ou staliniens.
Pendant ce temps, aujourd’hui, la barbarie continue à creuser ses sillons…
D’accord, inutile d’ouvrir ces liens, vous le saviez déjà. Et puis il fait trop chaud sur la planète alors on fait tourner les pales du ventilateur, tout en se doutant que ces réchauffements climatiques dont font partie les guerres n’en finiront sans doute que dans des explosions nucléaires. Boum !.. Boum et Boum !
Et la rafle du Vel d’Hiv, et Hiroshima, et les docteurs Folamour, finito ! Même plus d’écran ni de jus pour brancher la télé et regarder au fond du canapé la souffrance et l’ignominie de certains dirigeants. Regarder et se terrer. Sans rien faire. C’est le drame des faibles, sans doute.
15 07 2022
AK
(petite colère de pépère)
Boronali, ou les facéties de Roland Dorgelès (et ses potes).

Je vous invite à retrouver l’Art dans les années 1910, avec cet article qui en dépeint tous les artifices, si vous ne pouvez aller aux feux du XIV juillet.
Le 08 mars 1910, à Montmartre, le facétieux Roland Dorgelès et quelques amis de celui-ci réalisent un des plus incroyables canulars de l’histoire de l’Art, constaté par un huissier de justice. Le jeune journaliste expliquera qu’il voulait se moquer des peintres impressionnistes et de l’art contemporain envers lesquels il se veut critique.
Le reste de l’article est à lire en cliquant sur le lien, que voici voilà :

Pour lecture, je vous conseille « le Marquis de la Dèche », de Roland Dorgelès…
Les mardis de la poésie : Sabine Sicaud (1913-1928)

Poèmes extraits du site : https://www.poetica.fr/
Extrait de la biographie (poética.fr) :
Elle commence à écrire des poèmes en 1919 sur les agendas publicitaires de son grand-père. A l’âge de onze ans elle remporte le second prix au Jasmin d’argent de 1924 pour son poème « Le petit cèpe ». En 1925, elle remporte quatre autres prix, dont le grand prix des Jeux Floraux de France, pour le poème « Matin d’automne », écrit en 1922 quand elle n’avait que neuf ans.

Château de Biron
Sur les chemins nus, plus personne.
Couleur de sanguine pâlie
Un horizon de bois frissonne.
De quelle âpre mélancolie
Nous enveloppe ici l’automne ?
Un gémissement de poulie
Survit seul en haut du puits rond.
La cour d’honneur et le perron
En vain parleraient d’Italie…
Trop de couloirs sombres relient
Aux salles où nos pas résonnent
Des retraits que nous ignorons.
Trop d’ombre se tasse aux chevrons
Le long de frises abolies.
Feu le duc aux « souliers tout ronds »
A rejoint défunt Bragelonne.
Dans les cuisines, plus personne.
Le soir meurt, plein de moucherons.
Vieux château des Gontaut-Biron
Avec quelle mélancolie
Vous regardez venir l’automne…
Sabine Sicaud, Les poèmes de Sabine Sicaud, 1958 (Recueil posthume)

Chemins de l’Ouest
Sabine Sicaud
Pour qui vous a-t-on faits, grands chemins de l’Ouest ?
chemins de liberté que l’on suppose tels
et qui mentez sans doute…
Espaces où surgit le Popocatepelt,
où le noir séquoïa cerne d’étranges routes,
où la faune et la flore ont de si vastes ciels
que l’homme ne sait plus à quel étage vivre.
Chemins de liberté que nous supposons libres.
À travers les Pampas court mon cheval sans bride,
mais la ville géante a ses réseaux de feu,
et les jeunes mortels faits de toutes les races
ont leurs lassos, leurs murs, leur pères et leurs dieux.
Des » Trois Puntas » à la mer des Sargasses,
Amériques du Sud, du Nord,
pays des toisons d’or, des mines d’or, de l’or
qui fait l’homme libre et l’esclave,
le Pampero peut-être ignore les entraves
et l’aigle boréal, les pièges du chasseur…
Mais, ô ma liberté, plus chère qu’une soeur,
c’est en moi que tu vis, sereine et sédentaire,
pendant que les chemins font le tour de la terre.

Tirer la queue du Miquet

C’est fou comme parfois les jeunes vieillissent plus vite que les vieux fous qui leur ont sans doute quelque part volé leur adolescence (car ils se sentent jeunes, eux) avec des mots qu’ils comprenaient trop bien : l’Avenir, les Études, le Travail, la Politique. Tout cela est révolu, personne n’y croit plus. L’eau de Jouvence qui coulait de sources en fontaines a été avalée par des vieillards, des soiffards et les jeunes n’ont plus qu’à tirer sur la queue des miquets dans les manèges qui tournent en boucles musicales râpées sur leur smartphone, cette étrange stratégie du néant, stratégie que les vieux possèdent car eux n’ont plus d’avenir, juste un jeu : empêcher les gosses de grandir pour leur faucher la place auprès des filles qui ont toujours vingt ans.
On dit dans le petit pays que les falaises sont plus hautes que la chute. Que fallait-il comprendre dans cet adage ? S’agissait-il de la fin d’une phrase, d’une pensée, ou des reins de Louise ? Sans doute un peu de tout ça. La cambrure de Louise, l’angle qu’elle révélait de profil entre son fessier et son dos de nageuse (sans parler de la poitrine proéminente) entretenait le mythe, tant chez les jeunes que chez les vieux paillards du bourg attablés au bistrot faisant face au collège. Les autres cafés avaient fermé boutique car tous les clients les avaient désertés, je parle ici des clients qui tiraient depuis des années la queue du miquet, bref, des retraités. Voir sortir du collège ces jeunes enjoués qui ignoraient ce qui allait leur tomber dessus, le regard fixé sur leur smartphone, les réjouissaient.
Les vieux piliers de comptoir étaient toujours à « l’agachon », c’est à dire aux aguets. Les jeunes professeures de trente ans les intéressaient aussi, car ils se savaient exclus du paradis terrestre depuis que dieu avait décidé d’interdire le tirage de queues de miquets au profit du loto et d’autres jeux idiots pour lesquels ils pariaient depuis qu’ils étaient devenus parias. Après les cours, en cette période de vacances d’été proxime, trois professeures venaient s’étancher au bistrot et discouraient entre elles de leur antépénultième journée laborieuse, de leurs amants passés et à venir, et du temps des cerises, avec un accent moqueur que les pochetrons écoutaient avec attention. La plus jeune d’entre elles, Maryse, était la plus bavarde des trois. Elle achevait sa première année d’enseignement de Français et se demandait si elle ne ferait pas mieux d’apprendre la langue des signes en Bretagne pour que sa classe soit moins bruyante lors de son retour, fixé à dans quatre ans dans cet établissement (les trains bretons ayant des chapeaux de roues ronds).
Les agachonnistes scrutaient, l’air de rien Maryse, qui sous sa chemisette blanche en satin batifolait avec ses bras, les agitant comme des ailes d’oie , une Léda de province qui se prenait pour Zeus au palais de l’Élysée. Ces fins observateurs furent quelque peu déçus du fait que Maryse n’avait pas de poitrine, quand ses deux amies en avaient à revendre, vu leur ancienneté à maîtriser ces sales gosses auxquels on inculquait, année après année, l’Avenir, les Études, le Travail, la Politique. On raconte, dans le petit pays, que gueuler et enguirlander les enfants rétifs développe la poitrine des enseignantes de collège.(dixit le Maire)
Certes, Maryse n’avait ni poitrine ni soutien gorge, mais ses tétons pointaient comme des cannelés de chez Baillardran sous sa chemise légère. Ces vieux marauds en salivaient et commandaient à boire de l’eau de Jouvence de plus en plus virtuelle. La source et surtout la fontaine commençaient à couler à l’envers.
Dans deux jours les gosses seraient aussi cons mais libres d’aller plonger dans l’été torride qui s’annonçait. Tant qu’il y aurait de l’eau dans la piscine municipale et de la connexion dans le smartphone, peu leur importait la marche du monde. Faire des poutines aux filles, des fois aller plus loin, telle était leur vision du monde qui allait leur tomber dessus.
« Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe calme et volupté » (Baudelaire)
On dit dans le petit pays que les falaises sont plus hautes que la chute. Que fallait-il comprendre dans cet adage ? S’agissait-il de la fin d’une phrase, d’une pensée, ou des reins de Louise ? Sans doute un peu de tout ça. Il faut partager la responsabilité des uns et des autres. Les jeunes filles deviennent femmes les adolescents s’habillent en adultes responsables. Entre temps, la vie parcourt les moments décisifs de l’aventure humaine. Les vieux ne rêvent plus d’atteindre le sommet des montagnes, les jeunes en sont empêchés par des barrières sociales et financières. Hier survit encore et toujours à demain…
10 07 2022
AK
Zoologie- Botanique niveau 5ème, en 1947.

Voici une découverte parmi les livres que je m’apprêtais à jeter (la bibliothèque locale n’en prenant pas y compris des quasiment neufs et j’en ai un tas d’autres à mettre dans la boîte à livres du bourg), livre qui aurait pu faire partie du « Bestiaire » d’Alexandre Vialatte (1901-1977). Il s’agit d’un petit manuel intitulé : « Zoologie Botanique », écrit par le professeur A. Oria (à ne pas confondre avec A. Mora, l’un des créateurs(?) de la moutarde et des cornichons. Ce manuel est destiné à la classe de cinquième (classique, moderne, technique –et cours supplémentaires– datant de 1947.
C’est un petit bouquin illustré de dessins explicatifs qui traite à la fois des plantes (le polytric, le fucus vésiculeux, l’agaric champêtre où les schtroumpfs bâtissent leurs villages) et de xanthories des murailles dans lesquelles elles prospèrent en tant que lichens en ensemençant l’air de leurs pures amours (ce n’est pas dans le manuel, mais bon) lisons : « les bénéfices réciproques » « le champignon (la xanthorie) forme un feutrage, une éponge qui retient l’eau de pluie et capte la vapeur d’eau et en retient les poussières(,,,) »
Cependant, malgré la profusion de dessins et descriptions scientifiquement dessinées, je me suis émerveillé des « chapeaux », ces textes qui ouvrent chaque article.
Je passe les amibes, les protozoaires et l’éponge de toilette. Pour me chatouiller les pieds, le lombric ou ver de terre est plus stimulant vu mon âge. Je le relaterai donc ici ainsi que certains des énoncés des cours magistraux offerts aux classes de cinquième en 1947 .
Le Lombric
« Il est connu de tous. Les plus petits l’observent parce qu’il est à leur portée. Par temps humide, il rampe dans l’allée du jardin. La bêche, qui retourne le sol, le réclame à l’air. Il se faufile entre les mottes et rentre vite en son domaine : la terre »
Comment peut-on, en 2022, ne pas lire ce préambule au second degré ? Bon, passons Ascaris et Ténia. Sautons la moule, moulte fois disséquée avant que nous n’en apprenions, jeunes cons, l’aspect érotique.(écoliers de 1947)
Puis vint le plus beau : L’Escargot !
On brisait sa coquille en chocolat à Pâques, il fondait sous la langue avec parfois du pralin dans sa coquille. Mais le professeur Oria n’inculquait pas la même approche :
« Il a plu. Il fait humide et doux. Dans le jardin les escargots sont à leur aise. Les petits gris rampent et mangent. Ils rampent sur leur unique pied, le corps au maximum sorti de la coquille, les « quatre cornes » tendues. »
« Avec de forts ciseaux coupons la coquille et enlevons-la par fragments sans léser l’animal. Tout le corps apparaît, mou, sans aucune consistance. »
Tu m’étonnes, on vient de cambrioler son domicile, de vider sa columelle (axe creux où il s’enroule dans la coquille) pour y planquer son magot et ses limaces (argot : chemises). Professeur, est-il vrai que les gastéropodes sont hermaphrodites ? Pas de réponse.
Mais je ne vous relaterai pas la seiche, le scoubidou, l’oursin livide,la scolopendre, l’araignée des jardins, le scorpion languedocien,l’écrevisse, le chat du voisin, les coléoptères volants (dénommés drones), la sauterelle verte, oh, certainement pas, tant vous êtes nuls en zoologie et botanique, a dit M. Oria.
Mais si par hasard un vieil escargot attend que le feu passe au vert salade au carrefour n’hésitez pas : laissez-le traverser. Il comprendra alors que tous l’ont pris pour un emmerdeur . Sauf Prévert.
09 07 2022
AK

Ô Mamma mia !

Ce matin, vers onze heures, j’ai téléphoné à ma mère. Comme il n’y avait pas de tonalité, j’ai joint le service semi- public des télécoms, ou un service similaire de réclamation géré par un algorithme depuis sa lointaine planète. Le message a été clair : ce numéro a été inscrit dans le registre des abonnés absents. Pour les alcooliques anonymes, contacter le 20-20 en tapant le code Whisky. Si l’adresse que vous avez indiquée dans le formulaire est bien celle-ci : 98 boulevard des Allongés, à Puteaux, il s’agit effectivement de cette personne. Pour réécouter le message, tapez 5, avec votre main droite. Pour l’effacer tapez 3 avec votre main gauche. Merci de lécher l’écran de votre smartphone pour répondre à notre enquête de satisfaction.
A 16 heures, j’ai eu confirmation que ma mère venait de décéder après une longue série d’appels et qu’elle s’était fourvoyée en téléphonant à Dieu plutôt qu’au CHU, qui n’est, lui, qu’à une quarantaine de kilomètres, mais où l’on n’accepte pas les chiens non tenus en laisse ni les grabataires qui sentent les pieds sous terre. Autant l’avouer dès à présent, le chien de ma mère s’appelle Pascal Boniface. C’est mon père. A une époque, il exhibait des colliers de rappeur en faux or et des dents de Rottwailers incrustés de faux diamants parmi les immeubles de Puteaux. Il n’aurait pas fait de vieux os si moi, le cinquième enfant de la fratrie, n’avait remonté l’honneur de la famille en inventant le concept de poing sur la gueule, déclinable en claque et en bris de toute machine sujette aux algorithmes. Comment ça, ma mère est morte ? Pan sur ta chiffraison 2.0. (par exemple, un parmi d’autres). Puis je l’ai adaptée aux matches de football. 2-0 pour l’OM , ou 0-2 pour le PSG, qu’importe, ma mère était morte, ma bonne mère qui me regardait jouer au bord de la Méditerranée. Ô pauvre !
Vers dix huit heures j’ai reçu un coup de fil. Il n’y avait pas de numéro 98 au boulevard des Allongés, à Puteaux. Un bug informatique qui de fait m’informait que ma mère était certainement plus vivante que jamais. Allais-je pour autant croire en Dieu, ou à la Providence, plus charnue et aimable que le vieux barbu ?
Je pris mon smartphone et appelai un algorithme de mes amis, qui œuvrait sur la ligne Whisky et en abusait certainement car son message ne tenait visiblement pas les lignes rébarbatives de la programmation orgasmique des développeurs de légendes futuristes. Un peu de jus électrique semblait-il réclamer. Je lui rappelais que je lui avais offert un violon et qu’en pissant dedans il retrouverait les harmonies du temps, du tempo un deux trois quatre, on z’y va .
Finalement, j’ai retrouvé ma mère. Elle était dans les bras de Pascal Boniface, au pied d’un immeuble de Puteaux. Moi, grâce à mon pote algorithmique, je suis descendu en vitesse pour les rejoindre. C’est alors qu’il y a eu cette énorme panne électrique dont, aujourd’hui, personne ne se souvient. Parce que depuis ,il fait noir de jour comme de nuit.
04 07 2022
AK

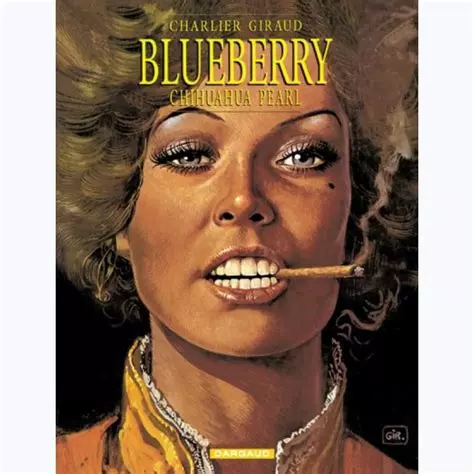

Mini petite souris…

Je connaissais la méthode italienne consistant à accrocher son imperméable à une patère du bureau et à filer au café ou chez sa maîtresse en faisant croire que le fonctionnaire était bel et bien présent, puisque son par-dessus était là, pendouillant au porte-manteau. Mais les temps ont changé, ainsi que le révèle le quotidien québécois La Presse.
Extrait de l’article :
Hydro-Québec a détecté une série d’incidents liés à l’installation de logiciels de mouvement de souris par des employés en télétravail, a appris La Presse. La société d’État dit prendre cette situation « très au sérieux » et pourrait appliquer des mesures disciplinaires.
« Ces logiciels ont connu une explosion de popularité depuis le début de la pandémie de COVID-19. Ils permettent aux employés qui travaillent de la maison de simuler leur présence devant leur ordinateur pendant qu’ils vaquent à d’autres activités, échappant ainsi à la surveillance potentielle de leurs patrons.
Dans un courriel envoyé à des salariés, obtenu par La Presse, Hydro souligne que le téléchargement de tels programmes « contrevient à deux règles de cybersécurité ». La société d’État interdit à ses employés d’installer des logiciels non autorisés afin de limiter les risques d’intrusion de virus ou de cyberattaques, une politique adoptée par bon nombre d’entreprises. »
L’article complet est à lire ici .
Les petits délits/res du dimanche

J’ai appris à lire dans le regard des autres mais pour les empêcher de lire dans mes pensées, je les ai assassinés, l’un après l’autre. J’ai commencé avec Germaine, une cousine qui vivait du côté de Lindau, en Allemagne. Nous avions sensiblement le même âge mais sa poitrine en avait deux d’avance sur ma sexualité. Elle riait beaucoup, ce qui m’exaspérait. Le silence, comme les jeux de carpes, était pour moi l’essentiel de ma jeune adolescence, d’autant que les jeux de carpettes m’étaient encore des sonorités inconnues. J’aimais étrangler dans un bois de bouleaux de jeunes vierges, et longtemps cette forme de crime m’a poursuivie. Raison pour laquelle en atteignant ma majorité mes conquêtes amoureuses se sont réduites à zéro. Pour meubler ce vide affectif, je me suis tourné vers les hommes, jeunes éphèbes qui se donnaient rendez-vous le soir dans les bois, entre chênes peupliers et haies de fusains moulant parfaitement leur taille. Mais ils me déçurent car la strangulation était plus difficile qu’avec les femmes aux cous de girafe. A vingt cinq ans, je fus embauché comme bûcheron dans une forêt du Morvan. Je hâlais de gros bourrins sur des sentiers boueux, des percherons d’une demi-tonne, qui tiraient au bout de leurs chaînes des troncs gigantesques que les chinois rachèteraient à prix d’or pour nous les renvoyer sous la forme de meubles en kit à monter soi-même avec une clé hexagonale et un tournevis made in Corée.
C’est dans ces forêts morvandelles que je rencontrai une famille de nains qui vivaient en autarcie depuis une dizaine d’années, ayant du fuir les jardins de petits vieux vicelards qui les exhibaient aux passants et les exploitaient sans honte, quand ils ne les vendaient pas à d’autres vieillards libidineux comme eux. Ils s’étaient acclimaté à leur nouvelle vie, et je pus lire dans leurs yeux qu’ils ignoraient mon parcours criminel. Je me sentais beaucoup de connivences avec eux, sachant que leur amabilité était liée au fait que mon passage régulier dans les layons avec mes deux canassons leur permettait de récolter une bonne moisson de crottin qu’ils utilisaient en permaculture pour faire pousser des champignons et des herbes sauvages leur servant de nourriture et entretenaient leur spiritualité débridée. Robur était leur chef, sa barbe était longue et parfaitement blanchie dans l’eau claire des ruisseaux sans pollutions, sauf les nocturnes. Au bout de quelques semaines nous sympathisâmes et je fus invité à dîner avec eux. Une grande famille : dix gosses, assis en rang d’oignons, deux grands-mères aux narines où poussaient du thym et des herbes de Provence, un oncle aux poils couleur carotte, trois épouses blanches comme la fleur de chou et d’autres invités très propres sur eux (sans doute des prêtres ayant apporté et béni des pains sylvestres). Nous rejoignirent deux olibrius qui vinrent compléter la table, bien mise pour y installer tant de convives.
Robur me fit visiter les alentours (pour éviter que je marche par mégarde sur leur habitation). Il me montra les revues auxquelles il était abonné : Reporterre, La Hulotte, Tout l’Opéra ou Presque (version papier), revues qu’il se fournissait avec la complicité de Maître Corbeau, un volatile très répandu dans le Morvan, contrairement aux cigognes qui ne transbahutent que des nouveaux-nés et des boîtes de petits gâteaux secs de la marque L ‘Alsacienne fabriqués chez Lulu, à Nantes. On les croque à l’envers, du côté de Nevers, avec un petit blanc rapporté de Nogent par les arrière-petits enfants de Mitterrand.
Vînt un moment où le débardage de bois me fatigua. Les chlitteurs étaient morts et ma vocation d’étrangleur impénitent s’étiolait. Étrangler un nain de jardin ou des bois à l’aide de sa longue barbe ne présentait plus d’intérêt. J’avais trente cinq ans. L’âge de créer un foyer. Mais qui voudrait de moi avec mon lourd passé? J’étais désemparé : trop jeune pour fréquenter les sites de rencontre, et dans les bois morvandiaux internet ne possédait pas d’antennes, vu qu’elles étaient ratiboisées par les bûcherons et revendues aux chinetoques comme grumes à valeur ajoutée, trop jeune aussi pour les sites archéologiques (bien que nombre de mes victimes y soient résidentes depuis des lustres, mais les os, c’est sacré, c’est comme un jeu de piste carpienne, une sous-marinade en mer Caspienne, un jeu de dupes qui soulève sa jupe avant de mettre les voiles vers l’Iran et ses carpettes aériennes).
Bref, j’étais seul dans ce monde obscur. La famille de Robur ronflait à en secouer la cîme des arbres. Lorsque je me souvins de ce petit carnet que j’avais toujours conservé dans la poche arrière de mon pantalon. Le carnet où, forfait après forfait, j’avais noté mes crimes. A ma grande surprise, toutes les feuilles étaient blanches : pas un nom, pas une adresse IP, pas même un dessin licencieux tracé de mes propres mains. Le carnet était désespéramment pur de toute pensée ou acte malsain. Pendant quelques minutes je me demandais si je devais appeler Poutine pour l’embrasser d’ainsi annihiler tous mes péchés. Puis je me ravisais. Pourquoi lui ? J’ai tant de numéros de téléphone dans ma petite cervelle, tant de salauds à appeler en mettant le haut-parleur à son intensité maximum. Et puis, réveiller Robur, sa famille et ses soucis existentiels, à quoi bon ?
Je me suis effondré sur un lit de mousse et ai attendu que tombe le crottin du cul des chevaux. A l’aube viendra la jument de Michao.
Je crois que je vais l’épouser, sa jument.
Chantez loups, renards et belettes, demain il fera beau !
03 07 2022
AK







Commentaires récents